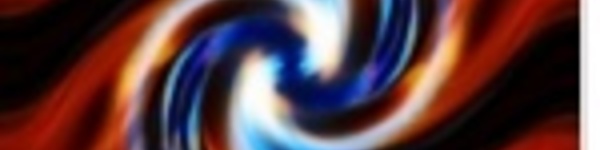Sophie Mendelsohn : Pourriez-vous nous expliquer comment se recrute aujourd’hui un enseignant-chercheur à l’Université ?
Alain Abelhauser : Je crois avoir compris, lors de la préparation de l’entretien, que vous souhaitiez savoir si j’étais disposé à assumer le rôle de l’enfant du conte d’Andersen, qui reconnaît que « le roi est nu »…. Soit.
Commençons par préciser que les universitaires sont pour la plupart des enseignants-chercheurs, c’est-à-dire des gens qui sont censés partager leur temps en deux, en en consacrant la moitié à la recherche, l’autre à l’enseignement. En France, la majorité des chercheurs se trouve donc à l’Université. Il faut préciser que celle-ci est un monde très hiérarchisé, à l’instar de ces autres institutions chères à Freud que sont l’Église et l’armée. À ce titre, les enseignants-chercheurs se divisent principalement en deux catégories : les maîtres de conférences et les professeurs des universités, elles-mêmes partagées en classes et en échelons.
Pour devenir maître de conférences (MC), il est nécessaire d’avoir passé une thèse de doctorat : c’est une condition nécessaire, mais qui est loin d’être suffisante. Lorsqu’on a sa thèse, on peut demander à être qualifié aux fonctions de MC par une instance nationale : le Conseil National des Universités (CNU) ; celui-ci est lui-même divisé en sections représentant les différentes disciplines de l’enseignement et de la recherche, soit presque une centaine de sections. Une fois le postulant qualifié par le CNU (pour une durée de 4 ans), il peut se présenter à tous les emplois de maître de conférences disponibles dans sa discipline en France. La qualification nationale permet donc de postuler ensuite à des emplois locaux. C’est la même chose pour les professeurs : il faut d’abord être qualifié aux fonctions de Professeur des Universités et ensuite candidater à des postes précis. Pour la qualification aux fonctions de professeur, il était nécessaire auparavant de disposer d’une thèse d’État (il s’agissait de l’ancien régime des thèses, qui en comportait deux, celle de « troisième cycle » et celle « d’État »). À présent qu’il y a un doctorat unique, appelé doctorat « nouveau régime », la qualification aux fonctions de Professeur suppose l’obtention d’une Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), qui présente l’ensemble des travaux que le candidat a menés depuis sa thèse et synthétise ses principaux résultats de recherche.
Sophie Mendelsohn : Quelle est la composition du CNU et quel est son mode de fonctionnement ?
Alain Abelhauser : Dans chaque section, le CNU est composé pour moitié de professeurs, pour moitié de maîtres de conférences. L’ensemble de la section siège quand il s’agit de qualifier des maîtres de conférences ; il n’y a que le corps des professeurs lorsqu’il s’agit de qualifier un professeur. Les sections du CNU se réunissent aussi pour examiner, par exemple, les changements de classes des professeurs et des maîtres de conférences, c’est-à-dire pour déterminer, sur dossier, leurs éventuelles promotions. (La progression de carrière se fait pour partie à l’ancienneté, pour partie au mérite ; à chaque classe, et à chaque échelon d’une classe, correspond un niveau de salaire : un maître de conférence débutant, sans carrière préalable dans l’enseignement, gagne 1600 euros net, et un professeur de classe exceptionnelle — soit, en psychologie, un peu moins de 2 % des enseignants-chercheurs — en toute fin de carrière, environ 4500 euros.)
Chaque corps siégeant au CNU – maîtres de conférences et professeurs – est composé pour les deux tiers de membres élus et pour un tiers de membres nommés par le ministère. C’est l’ensemble des membres d’une section — l’ensemble des enseignants-chercheurs français en psychologie, par exemple — qui élit ses représentants au CNU, pour 4 ans, à partir de listes qui sont le plus souvent de nature syndicale.
Sophie Mendelsohn : Quels sont les critères sur lesquels la section du CNU qualifie un enseignant-chercheur ?
Alain Abelhauser : Rappelons d’abord que, dans toutes les disciplines, la thèse est nécessaire pour être nommé maître de conférences et l’HDR pour être nommé professeur. Chaque discipline, ensuite, met en place des critères qui lui sont propres et relativement variables, d’une discipline l’autre, d’une part, et d’un moment l’autre, d’autre part. En psychologie, où l’on prétend « faire sérieux » en copiant, voire en singeant, les coutumes prêtées aux scientifiques purs et durs, on voit de plus en plus apparaître des critères supposés objectifs parce que « chiffrables », et qui renvoient de fait la tâche de « l’évaluation » à d’autres acteurs.
Je m’explique. Un dossier est traditionnellement examiné selon trois axes : l’enseignement, la recherche, l’administration. En psychopathologie, il est encore admis — mais pour combien de temps ? — que s’y rajoute un quatrième, celui de l’expérience clinique. Actuellement, pour devenir maître de conférences en psychologie, on attend donc des candidats qu’ils aient, en premier lieu, suivi un cursus de formation complet en psychologie, puis qu’ils aient, d’une part, une expérience importante de l’enseignement de la psychologie à l’université et, d’autre part, qu’ils puissent témoigner de leur recherche autrement que par leur thèse, c’est-à-dire qu’ils aient publié (nous en sommes aujourd’hui à deux, voire trois, articles publiés dans des revues dites « qualifiantes » – nous y reviendrons). L’expérience administrative est, logiquement, peu prise en compte à ce niveau. Enfin, pour les candidats d’orientation clinique, une véritable expérience dans ce domaine est encore attendue, mais ce critère s’amenuise et l’on voit arriver de plus en plus de dossiers de candidats en psychopathologie qui n’ont rencontré de sujets en souffrance, sur un plan professionnel, que lors des quelques entretiens qu’ils ont menés pour mettre en place l’échelle de dépression ou d’anxiété grâce à laquelle ils ont pu ensuite publier dix variantes du même article dans diverses revues anglo-saxonnes bien cotées. Je n’exagère pas.
La psychologie correspond à la seizième section du CNU, qui regroupe la psychologie — générale, développementale et cognitive — la psychologie sociale et la psychologie clinique. Toutes les sous-disciplines de la psychologie, comme on les appelle, sont donc regroupées dans la même section. Et elles sont censées avoir les mêmes critères, qui privilégient, comme je viens d’y insister, la recherche, en supposant que la publication d’articles dans les revues « qualifiantes » est la seule véritable façon d’en attester, parce que ce sont des gens « extérieurs » au CNU — les experts des revues — qui se sont prononcés sur sa pertinence. Reste à savoir, bien sûr, qui sont ces « experts », et à se demander alors, et par ailleurs, s’il n’y aurait pas lieu de distinguer deux sections : une de psychologie cognitive et une de psychologie clinique et pathologique.
Pour devenir professeur, c’est à peu près la même chose, à un autre niveau. Il y a environ trois fois plus de maîtres de conférences que de professeurs. La maîtrise de conférences est d’ailleurs le passage presque obligé pour le professorat. Pour accéder à ce dernier, il faut avoir enseigné à tous les niveaux du cursus et avoir déjà dirigé des recherches de second, voire de troisième, cycles (comme il faut en principe être habilité pour cela, on ne peut le faire que sous la caution d’un professeur en titre). Il faut avoir exercé des responsabilités administratives : avoir été membre de conseils centraux de l’université, responsable de cycles ou de filières d’enseignement, etc. Et surtout avoir publié : entre dix à quinze articles, au moins, dans les fameuses revues qualifiantes. Quant aux ouvrages, c’est selon : c’est inutile, conseillé, ou nécessaire selon les moments.
Certains de ces critères peuvent en partie se compenser. Mais, quels que soient la qualité de l’enseignement de quelqu’un et ses compétences dans tous les autres domaines, s’il ne peut arguer du nombre voulu d’articles publiés, il ne sera pas qualifié.
SM : Qu’est-ce qu’une « revue qualifiante » ?
AA : Il n’y a là, bien sûr, pas de définition autre qu’arbitraire. On a tenté, dans un premier temps, de caractériser une revue « qualifiante » grâce à des critères formels : par exemple, que les articles qui y figurent soient expertisés, de façon anonyme et sans concertation, par deux lecteurs différents, l’idée étant de garantir ainsi l’objectivité du jugement. On a aussi pensé définir ces revues par des critères de reconnaissance dans le milieu scientifique, de normes de publication, d’existence d’un comité de lecture et d’un comité scientifique, de composition de ceux-ci, etc. On comprend bien que la limite de ces critères est d’être, sur un plan, très formels — presque n’importe quelle revue peut arriver à s’en doter sur papier — et, sur un autre, de ne pas pouvoir éviter les jeux de pression, les phénomènes de lobby et les renvois d’ascenseur. Qu’est-ce qui permet de publier dans telle ou telle revue ? La qualité de l’article soumis, sa conformité à l’idéologie sous-jacente ou le réseau de relations et d’appuis de son auteur ? On se gardera de se prononcer. En fait, on est pris à ce propos dans une hésitation entre, d’un côté, le bon sens — établir une liste consensuelle de revues considérées par la communauté scientifique comme présentant des garanties de sérieux suffisantes, et l’afficher — et, d’un autre, la prétention à se parer des couleurs de la science dure, au prix le plus souvent d’une surenchère dont on oublie — les exemples « scientifiques » en sont pourtant nombreux — qu’elle n’offre à terme pas plus de garanties que la « mollesse » qu’elle entend dépasser. Dernier avatar de cette dernière tendance : prendre comme critère des revues « qualifiantes » le fait qu’elles apparaissent dans tel ou tel type d’index. Le problème est ainsi déplacé d’un cran : ce sont les index qui garantissent le sérieux des revues, lesquelles garantissent aux gens qui y publient le sérieux de leurs recherches, lesquelles garantissent aux membres du CNU la valeur des candidats. Quelqu’un a prétendu un jour qu’il n’y avait pas d’Autre de l’Autre … Il est clair qu’il n’a pas été entendu de tous ! Le problème de la critérisation des revues qualifiantes n’est donc toujours pas réglé ainsi ; de plus, quelle indexation va-t-on reconnaître en psychologie ? Les Current Contents, Psychinfo, Medline ? La question, comme je le disais auparavant, a simplement été repoussée, en confiant à d’autres (ou supposés tels) le choix des critères de qualification.
Peut-être est-ce là le fond du problème. Les commissions du CNU reconnaissent, implicitement ou explicitement, n’avoir pas le temps, voire pas les compétences, pour expertiser les recherches des candidats. Ou craignent, si elles s’y risquent, d’entrer dans un débat d’experts qui aurait toutes les chances d’être interminable. Alors elles choisissent de se reposer sur d’autres pour faire cette évaluation — les experts des revues — en les ayant soumis eux-mêmes préalablement à l’expertise du référencement. C’est une vraie logique obsessionnelle qui est ici à l’œuvre ; ce qui est regrettable est qu’elle conduit finalement, d’une part, à ne même plus lire ce que le candidat a produit, puisque de toute façon le jugement qui pourrait en découler ne serait pas reçu par la commission. Et, d’autre part, qu’elle participe d’un véritable processus de stérilisation, en promouvant le conformisme et en privilégiant le respect des pures formes à l’inventivité, voire même au contenu. Je m’explique. Si je veux publier un article, et que je souhaite qu’il soit facilement accepté, j’ai intérêt non seulement à ce qu’il s’inscrive bien dans l’orientation de la revue à laquelle je le propose — et que j’ai soigneusement ciblée auparavant — mais aussi qu’il corresponde étroitement à toutes ses normes. Ce qui veut dire deux choses. Ou je ne publie que dans le petit cercle de mes « amis », et toute la question est évidemment celle de son empan et de sa reconnaissance : si mes « amis » sont puissants, j’ai toutes les chances de le devenir à mon tour. Ou je prends le risque de « l’exogamie », mais alors il faut que je colle au plus près aux valeurs et à la culture de qui je prétends épouser. Ce qui implique la plupart du temps que je ne vais rien apporter de neuf, mais simplement permettre au système de se perpétuer. Un exemple ? J’ai publié il y a quelques années dans le Journal of Clinical Psychology. L’article me paraissait suffisamment lénifiant pour être accepté par une revue américaine, et il avait été traduit par une vraie professionnelle. Il a effectivement été accepté moyennant quelques corrections. Celles-ci en ont entraîné d’autres, plutôt formelles (au fil des navettes, la rédactrice en chef de la revue a d’ailleurs fini par s’étonner qu’on n’ait pas davantage pris la peine de suivre les prescriptions d’un guide, dont nous ignorions jusqu’alors l’existence. Nous l’avons acheté à New York, et découvert un monument de plusieurs centaines de pages expliquant tout — toutes les règles à suivre pour écrire un article formellement inattaquable selon l’idéologie américaine, c’est-à-dire parfaitement « politicaly correct »). Nous avons alors tout fait comme il faut et l’article a été définitivement accepté (quand cela a été le cas, la rédactrice nous a gentiment écrit : « bravo, ça y est ; il n’y a plus maintenant qu’à traduire l’article en américain ! », ce qui suggérait que sa première traduction anglaise n’usait pas du « bon » anglais. Et nous l’avons fait ; nous avons trouvé quelqu’un qui ne fait que cela : retraduire des articles pour les mettre en conformité avec les us considérés). Puis il a été publié et nous en avons été très contents ; la seule chose était qu’il avait été tellement poli qu’il ne restait plus grand chose de son propos original, et que le vif de sa thématique avait été soigneusement arasé.
SM : Des regrets ?
AA : De ce petit épisode ? Non, bien sûr, cela fait quelque chose à raconter. Mais de cette évolution, qui consiste à se vouloir plus « scientifique que le scientifique », en confondant rigueur et chiffrage, en s’alignant sur l’idéologie anglo-saxonne et en stérilisant le contenu de ses propos, parce que ce n’est finalement que lorsqu’on ne dit rien qu’il n’y a rien à y redire, oui, certainement, j’ai des regrets, et plus que cela : des craintes sérieuses quant à l’avenir de notre discipline, et des réserves à mesure !
J’insiste : ce système qui conduit à s’inscrire dans un réseau donné et à être porté par lui, parce qu’on y publie ce qui, a priori, correspond à ce qui est acceptable, ou bien qui veut qu’il n’y ait de valorisé que ce qui est « international », mais en assimilant l’international au label anglo-saxon, est à terme mortifère. Je pense que ce n’est qu’un mauvais moment à passer, et que l’intelligence reprendra ses droits, mais en attendant, c’est toute une discipline qui, croyant ainsi acquérir ses lettres de noblesse — que je trouve pour ma part plutôt douteuses — en paye le prix. Et l’un de ses versants — la psychopathologie — qui s’en trouve particulièrement pénalisé, en grande partie malgré lui, pour des raisons qui lui échappent et en y perdant finalement sa raison d’être.
Qu’on me comprenne bien : qu’on apprécie l’activité d’un candidat par ce qu’il en montre publiquement, c’est-à-dire par ses publications, soit. Et qu’on établisse une liste de supports de publication, comme l’avait fait entre autres l’AEPU (Association des Enseignants de Psychologie à l’Université), qui paraissent raisonnablement sérieux à une partie importante de la communauté scientifique, soit encore. (Ce qui permet de surcroît, en affichant cette liste, de rendre à peu près transparentes les règles du jeu proposé aux candidats.) Mais qu’on sacralise certains critères au nom de la science (qui, justement, reconnaît bien plus de nuances et de complexité à la chose), c’est aussi risible que préjudiciable.
SM : Revenons à la façon dont se passe un recrutement à l’Université. Une fois que l’étape de la qualification a eu lieu, que se passe-t-il ?
AA : Je récapitule : j’ai présenté mon dossier de qualification en décembre et ai appris en février que je suis qualifié (pour 4 ans). Le Journal Officiel publie ensuite la liste des postes vacants, ou susceptibles de l’être, et ouverts au recrutement. Je peux alors candidater à ceux de mon choix courant mars. On examinera mon dossier dans chaque université, me retiendra éventuellement pour une audition et, toujours éventuellement, me classera premier des candidats, ce qui me permettra d’être nommé au poste de cette université au mois de septembre suivant (et par voie de conséquence, d’obtenir le titre correspondant). En tout — et c’est vraiment le meilleur des cas — il m’a fallu un an, à partir de ma soutenance de thèse, pour obtenir un poste dans l’enseignement supérieur.
Pour recruter un candidat, chaque département de chaque université constitue une Commission de Spécialistes (CS) qui correspond à une section du CNU. Cette Commission est, comme le CNU, composée à parité par des professeurs et des maîtres de conférences, élus par l’Assemblée Générale du Département concerné. Certains sont membres du Département, d’autres sont enseignants dans une autre université, afin d’éviter trop d’effets « locaux ». (L’idée est bonne sur papier, mais moins dans la réalité, car nombreux sont les professeurs, par exemple, membres de plusieurs commissions — qui ont toutes lieu presque en même temps —, ce qui entraîne pendant quelques semaines en France une sorte de gigantesque chassé-croisé des candidats et de ceux qui les auditionnent.)
Précisons que les emplois vacants le sont parce que leur titulaire prend sa retraite ou change d’université, ou parce que le poste vient d’être créé ou « redéployé ». (Est plus ou moins utilisée, à l’université, une norme d’encadrement pédagogique, prenant en compte le nombre d’étudiants inscrits dans une discipline, le nombre d’heures d’enseignement délivrées, et le nombre d’enseignants statutaires. Au bout d’un certain temps, il peut arriver qu’un poste devenu vacant dans une discipline qui n’a presque plus d’étudiants soit réaffecté à une autre discipline qui, elle, est peu « encadrée ».) De ce point de vue, rappelons aussi que la psychologie est la discipline qui, en France, a connu la plus grande progression du nombre d’étudiants, ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes, nous allons peut-être y revenir. (Plus de 40 000 étudiants dans l’ensemble des cursus et dans toute la France ; et 3 000 diplômés chaque année, soit le quart des psychologues formés dans toute l’Europe.) Le nombre d’enseignants de psychologie s’est également accru, mais pas en proportion, ce qui peut conduire à des crises sérieuses, comme récemment encore, à l’université de Brest, qui souffre d’un sous-encadrement chronique en psychologie.
Revenons au recrutement. C’est donc le département (ou l’UFR) qui fixe, par votes, un profil de poste, et le transmet à la commission de spécialistes, qui examine alors les dossiers reçus, en retient certains pour auditions et classe les candidats. Ce classement est ensuite avalisé par le Conseil d’Administration de l’université. On a vu récemment — vous comprendrez que ma position institutionnelle me condamne à une certaine réserve — un Conseil d’UFR voter un texte préconisant qu’il n’y ait plus, dans leur université, de recrutements en psychopathologie de candidats témoignant d’une référence à la psychanalyse ! Une mesure aussi discriminatoire a provoqué évidemment un certain tollé, le texte a été en partie amendé (on y parle désormais d’exigence de pluralité des références), mais il est symptomatique d’un mouvement de fond, dont on a observé d’autres manifestations, tout aussi inquiétantes, dans d’autres universités.
(Participe par exemple aussi de ce mouvement — appelons-le par son nom : de chasse à la sorcière psychanalytique, dont témoignent autant Le livre noir que certaine récente expertise de l’INSERM — ce que j’évoquais tout à l’heure : l’arrivée sur le marché de candidats à la maîtrise de conférences, voire au professorat, en psychopathologie, n’ayant aucune expérience clinique, mais un dossier de publications à première vue irréprochable. En fait, si on y réfléchit bien, on s’aperçoit que ce n’est même pas la psychanalyse qui est ainsi visée, mais l’approche clinique dans son ensemble, au profit d’une orientation qu’on qualifie — parfois un peu hâtivement, d’ailleurs — de « cognitivo-comportementale », et qui n’est qu’un mélange d’empirisme réducteur et d’épidémiologie a-théorique et mal pensée.)
J’ajouterai ceci : l’Université est un monde somme toute très paradoxal. Elle se veut démocratique et auto-gérée, et conserve malgré tout des traditions de féodalité affirmée, comme David Lodge s’est malicieusement plu à le souligner. C’est une démocratie auto-gérée : nous édictons une partie de nos règles, élisons des collègues pour les appliquer et exercer la plupart des responsabilités administratives qu’elle implique. Ce n’est pas toujours ce qu’il y a de plus simple et de plus efficace, mais nous y sommes attachés, et convaincus, pour nombre d’entre nous, que les inconvénients ainsi présentés ne sont à tout prendre qu’un moindre mal. Mais c’est aussi une survivance féodale : les départements, les équipes de recherche, correspondent souvent à des formes de « fiefs » où règnent encore volontiers ceux qu’on appelait auparavant des « mandarins ». Même s’ils n’ont plus, souvent, que les oripeaux de leur ancien pouvoir, ils restent directeurs des thèses, et donc de la formation des futurs enseignants-chercheurs, ils sont responsables des axes de recherche des laboratoires, etc. Les incidences en sont réelles ; cela permet de comprendre comment il suffit parfois d’une seule personne pour déterminer pendant un moment — parfois 10 à 20 ans — l’orientation de tout un pôle disciplinaire, et de ce qu’il implique.
SM : Tout ceci a-t-il un rapport avec la récession de la psychanalyse à l’Université ? Et comment expliquer celle-ci ?
AA : La psychanalyse à l’université … Il y a, on le sait, quelques rarissimes — exceptionnels est le mot le plus juste — départements de psychanalyse en France ; il y a aussi de nombreux endroits, et de nombreuses disciplines, où des enseignements sur la psychanalyse, ou qui convoquent la psychanalyse, ont lieu ; et puis il y a les départements, ou les UFR, de psychologie qui comportent un enseignement de psychopathologie, lequel peut être référé en (bonne) partie à la psychanalyse. Compte tenu de l’infléchissement des études de psychiatrie et de la diminution du nombre d’étudiants qui les suivent, c’est là, dans ces cursus de psychopathologie, que se tient le plus grand nombre d’enseignements qui en appellent à la psychanalyse. Je ne parlerai ici que de ceux-ci, dans la simple mesure où ils constituent l’occasion la plus fréquente de rencontre, pour un étudiant, avec la psychanalyse.
Traditionnellement, les études de psychologie, en France, se répartissent en quatre versants (susceptibles eux-mêmes de se subdiviser) : psychologie générale et expérimentale, psychologie de l’enfant, psychologie sociale, et psychologie clinique et pathologique. Ce dernier versant, qui représente habituellement le quart des enseignements de la formation de premier cycle, est pourtant celui qui draine ensuite, dès qu’ils en ont le choix, la grande majorité des étudiants. Ce qui avait d’ailleurs donné lieu à une forme de gentlemen's agreement un peu particulier : les départements de psychologie, à tendance, disons, cognitive, hébergeaient les enseignements de psychopathologie et leur donnaient une sorte de caution et, « en échange », les enseignements de psychopathologie apportaient à la psychologie les effectifs étudiants dont celle-ci avait besoin pour se développer.
Or deux choses sont en train de changer. D’une part, je l’ai déjà évoqué, commence à émerger en France, sur le modèle anglo-saxon, une psychopathologie qui, au mieux, n’a plus de clinique que le nom, et dont les références, pseudo-scientifiques, sont délibérément a-théoriques et fondées sur une conception, disons, mécaniste de l’humain. D’autre part, un certain nombre d’enseignants de psychologie cognitive voient dans cette émergence la possibilité de recycler leurs travaux, de leur trouver de nouveaux champs d’application et de nouveaux débouchés. C’est, pensent-ils, la possibilité d’attirer à eux le flux d’étudiants dont ils étaient privés jusqu’alors, et de se passer ensuite de cet encombrant voisin — les « cliniciens psychopathologues d’obédience psychanalytique ! » —, qui faisait décidément tâche dans le paysage, les déconsidérait sur le plan scientifique et avec lequel il fallait pourtant bien composer. La loi, et ses décrets d’application, sur l’usage du titre de psychothérapeute sont bien sûr un élément supplémentaire dans cette partie : la possibilité de former à bon compte des psychothérapeutes comportementalistes, avec la caution et les moyens de l’université, ne se présente-t-elle pas d’un coup ? Avec tous les avantages qu’elle comporte ? N’est-ce pas un beau rêve, soudain à portée de main ?
Je vais dire les choses très nettement : la psychopathologie, telle que nous l’entendons, telle qu’elle existe actuellement en France — et on peut considérer, à ce titre, qu’elle fait quasiment figure « d’exception culturelle », qui me semble précieuse —, la psychopathologie est en danger. À l’université et, à terme, partout ailleurs. Et avec elle la psychanalyse. Les psychanalystes en sont-ils bien conscients ? Je suis loin d’en être sûr. C’est dommage pour eux. J’ai bien peur qu’ils ne se réveillent un peu tard. Et j’irai encore plus loin : ce n’est pas seulement la psychopathologie et, avec elle, la psychanalyse, qui sont en danger. C’est aussi l’approche clinique dans son ensemble — on s’en rend bien compte en médecine —, c’est-à-dire la prise en compte de la singularité du cas, la prise en compte du « malade » plutôt que de la « maladie », qui est menacée — et, avec elle, une forme d’intelligence des choses qui est battue en brèche.
J’aimerais penser qu’il n’est pas trop tard, que les combats que nous menons ne relèvent pas de la défense des espèces en voie de disparition, que la clinique n’est pas devenue une sorte d’ours polaire en mal de banquise qu’il est urgent de ranimer. Mais n’est-ce pas une illusion de plus ?
SM : Comment cette menace est-elle mise en œuvre, à l’université ?
AA : J’en ai déjà parlé. En psychologie, « l’accord tacite » de partage du territoire entre cognitivistes et cliniciens est remis en question. Par ailleurs, la « féodalité » de l’université implique que des équilibres précaires reposent souvent sur quelques personnes. Il suffit parfois d’un départ à la retraite, d’une mutation et d’une mise en disponibilité pour changer tout un paysage local … On constate depuis deux, trois, ans que le nombre de candidats qualifiés en psychopathologie clinique diminue, que ce soit au niveau maître de conférences ou professeur, et que l’expérience clinique dont peuvent arguer certains de ces candidats diminue elle aussi dangereusement. Les critères de qualification et de recrutement dont j’ai parlé n’y sont bien sûr pas pour rien. C’est toute la formation de nouvelles générations qui est en jeu, mais aussi la transmission de valeurs, de pratiques, d’une éthique. Sur un autre plan, les cursus d’études changent, du fait du passage au LMD, bien sûr, mais aussi du fait de l’évolution générale de l’université, des politiques qu’on y applique. Des projets de numerus clausus sont par exemple à l’étude pour l’entrée en master 1 de psychologie, projets qui, en l’état, et selon les critères qui seront utilisés et les fins recherchées, peuvent paraître particulièrement inquiétants. Enfin, de nouvelles structures se mettent en place : l’ANR (Agence Nationale de la Recherche), l’Agence Nationale de l’Évaluation, les PRES (Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur), qui vont en partie changer les règles du jeu et les enjeux de l’université, et certainement davantage dans le sens d’une promotion des critères high tech dont j’ai déploré les effets pervers, que dans le souci des particularités culturelles et le respect des différences dont nous pouvons aussi nous réclamer.
Face à cela, quels sont nos atouts ? La résistance, façon village gaulois, isolé mais luttant courageusement contre l’envahisseur « c-c » — pardon, contre l’envahisseur romain ? Ou de nouveaux développements, appuyés tant sur nos acquis théoriques et sur notre pratique de l’enseignement, qui continuent à nous attirer l’audience et la confiance de très nombreux étudiants, que sur des alliances avec les praticiens du soin psychique soucieux de ne pas laisser perdre l’héritage clinique qu’ils ont reçu, avec des politiques soucieux de ne pas laisser l’université perdre sa mission publique, avec des scientifiques soucieux de ne pas laisser la science devenir une caricature d’elle-même ?
La réponse s’impose d’elle-même, me semble-t-il. Ce qui laisse présager encore quelques péripéties à venir. Je serai ravi d’en reparler ici avec vous.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sophie Mendelsohn
Alain Abelhauser est psychanalyste et Professeur des Universités (psychopathologie clinique). Il est également second vice-président de l’Université Rennes 2, vice-président du CEVU (Conseil des Études et de la Vie Universitaire) et des formations. Il est, enfin, secrétaire général du SIUEERPP.
Source : Site de l'Oedipe
Alain Abelhauser : Je crois avoir compris, lors de la préparation de l’entretien, que vous souhaitiez savoir si j’étais disposé à assumer le rôle de l’enfant du conte d’Andersen, qui reconnaît que « le roi est nu »…. Soit.
Commençons par préciser que les universitaires sont pour la plupart des enseignants-chercheurs, c’est-à-dire des gens qui sont censés partager leur temps en deux, en en consacrant la moitié à la recherche, l’autre à l’enseignement. En France, la majorité des chercheurs se trouve donc à l’Université. Il faut préciser que celle-ci est un monde très hiérarchisé, à l’instar de ces autres institutions chères à Freud que sont l’Église et l’armée. À ce titre, les enseignants-chercheurs se divisent principalement en deux catégories : les maîtres de conférences et les professeurs des universités, elles-mêmes partagées en classes et en échelons.
Pour devenir maître de conférences (MC), il est nécessaire d’avoir passé une thèse de doctorat : c’est une condition nécessaire, mais qui est loin d’être suffisante. Lorsqu’on a sa thèse, on peut demander à être qualifié aux fonctions de MC par une instance nationale : le Conseil National des Universités (CNU) ; celui-ci est lui-même divisé en sections représentant les différentes disciplines de l’enseignement et de la recherche, soit presque une centaine de sections. Une fois le postulant qualifié par le CNU (pour une durée de 4 ans), il peut se présenter à tous les emplois de maître de conférences disponibles dans sa discipline en France. La qualification nationale permet donc de postuler ensuite à des emplois locaux. C’est la même chose pour les professeurs : il faut d’abord être qualifié aux fonctions de Professeur des Universités et ensuite candidater à des postes précis. Pour la qualification aux fonctions de professeur, il était nécessaire auparavant de disposer d’une thèse d’État (il s’agissait de l’ancien régime des thèses, qui en comportait deux, celle de « troisième cycle » et celle « d’État »). À présent qu’il y a un doctorat unique, appelé doctorat « nouveau régime », la qualification aux fonctions de Professeur suppose l’obtention d’une Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), qui présente l’ensemble des travaux que le candidat a menés depuis sa thèse et synthétise ses principaux résultats de recherche.
Sophie Mendelsohn : Quelle est la composition du CNU et quel est son mode de fonctionnement ?
Alain Abelhauser : Dans chaque section, le CNU est composé pour moitié de professeurs, pour moitié de maîtres de conférences. L’ensemble de la section siège quand il s’agit de qualifier des maîtres de conférences ; il n’y a que le corps des professeurs lorsqu’il s’agit de qualifier un professeur. Les sections du CNU se réunissent aussi pour examiner, par exemple, les changements de classes des professeurs et des maîtres de conférences, c’est-à-dire pour déterminer, sur dossier, leurs éventuelles promotions. (La progression de carrière se fait pour partie à l’ancienneté, pour partie au mérite ; à chaque classe, et à chaque échelon d’une classe, correspond un niveau de salaire : un maître de conférence débutant, sans carrière préalable dans l’enseignement, gagne 1600 euros net, et un professeur de classe exceptionnelle — soit, en psychologie, un peu moins de 2 % des enseignants-chercheurs — en toute fin de carrière, environ 4500 euros.)
Chaque corps siégeant au CNU – maîtres de conférences et professeurs – est composé pour les deux tiers de membres élus et pour un tiers de membres nommés par le ministère. C’est l’ensemble des membres d’une section — l’ensemble des enseignants-chercheurs français en psychologie, par exemple — qui élit ses représentants au CNU, pour 4 ans, à partir de listes qui sont le plus souvent de nature syndicale.
Sophie Mendelsohn : Quels sont les critères sur lesquels la section du CNU qualifie un enseignant-chercheur ?
Alain Abelhauser : Rappelons d’abord que, dans toutes les disciplines, la thèse est nécessaire pour être nommé maître de conférences et l’HDR pour être nommé professeur. Chaque discipline, ensuite, met en place des critères qui lui sont propres et relativement variables, d’une discipline l’autre, d’une part, et d’un moment l’autre, d’autre part. En psychologie, où l’on prétend « faire sérieux » en copiant, voire en singeant, les coutumes prêtées aux scientifiques purs et durs, on voit de plus en plus apparaître des critères supposés objectifs parce que « chiffrables », et qui renvoient de fait la tâche de « l’évaluation » à d’autres acteurs.
Je m’explique. Un dossier est traditionnellement examiné selon trois axes : l’enseignement, la recherche, l’administration. En psychopathologie, il est encore admis — mais pour combien de temps ? — que s’y rajoute un quatrième, celui de l’expérience clinique. Actuellement, pour devenir maître de conférences en psychologie, on attend donc des candidats qu’ils aient, en premier lieu, suivi un cursus de formation complet en psychologie, puis qu’ils aient, d’une part, une expérience importante de l’enseignement de la psychologie à l’université et, d’autre part, qu’ils puissent témoigner de leur recherche autrement que par leur thèse, c’est-à-dire qu’ils aient publié (nous en sommes aujourd’hui à deux, voire trois, articles publiés dans des revues dites « qualifiantes » – nous y reviendrons). L’expérience administrative est, logiquement, peu prise en compte à ce niveau. Enfin, pour les candidats d’orientation clinique, une véritable expérience dans ce domaine est encore attendue, mais ce critère s’amenuise et l’on voit arriver de plus en plus de dossiers de candidats en psychopathologie qui n’ont rencontré de sujets en souffrance, sur un plan professionnel, que lors des quelques entretiens qu’ils ont menés pour mettre en place l’échelle de dépression ou d’anxiété grâce à laquelle ils ont pu ensuite publier dix variantes du même article dans diverses revues anglo-saxonnes bien cotées. Je n’exagère pas.
La psychologie correspond à la seizième section du CNU, qui regroupe la psychologie — générale, développementale et cognitive — la psychologie sociale et la psychologie clinique. Toutes les sous-disciplines de la psychologie, comme on les appelle, sont donc regroupées dans la même section. Et elles sont censées avoir les mêmes critères, qui privilégient, comme je viens d’y insister, la recherche, en supposant que la publication d’articles dans les revues « qualifiantes » est la seule véritable façon d’en attester, parce que ce sont des gens « extérieurs » au CNU — les experts des revues — qui se sont prononcés sur sa pertinence. Reste à savoir, bien sûr, qui sont ces « experts », et à se demander alors, et par ailleurs, s’il n’y aurait pas lieu de distinguer deux sections : une de psychologie cognitive et une de psychologie clinique et pathologique.
Pour devenir professeur, c’est à peu près la même chose, à un autre niveau. Il y a environ trois fois plus de maîtres de conférences que de professeurs. La maîtrise de conférences est d’ailleurs le passage presque obligé pour le professorat. Pour accéder à ce dernier, il faut avoir enseigné à tous les niveaux du cursus et avoir déjà dirigé des recherches de second, voire de troisième, cycles (comme il faut en principe être habilité pour cela, on ne peut le faire que sous la caution d’un professeur en titre). Il faut avoir exercé des responsabilités administratives : avoir été membre de conseils centraux de l’université, responsable de cycles ou de filières d’enseignement, etc. Et surtout avoir publié : entre dix à quinze articles, au moins, dans les fameuses revues qualifiantes. Quant aux ouvrages, c’est selon : c’est inutile, conseillé, ou nécessaire selon les moments.
Certains de ces critères peuvent en partie se compenser. Mais, quels que soient la qualité de l’enseignement de quelqu’un et ses compétences dans tous les autres domaines, s’il ne peut arguer du nombre voulu d’articles publiés, il ne sera pas qualifié.
SM : Qu’est-ce qu’une « revue qualifiante » ?
AA : Il n’y a là, bien sûr, pas de définition autre qu’arbitraire. On a tenté, dans un premier temps, de caractériser une revue « qualifiante » grâce à des critères formels : par exemple, que les articles qui y figurent soient expertisés, de façon anonyme et sans concertation, par deux lecteurs différents, l’idée étant de garantir ainsi l’objectivité du jugement. On a aussi pensé définir ces revues par des critères de reconnaissance dans le milieu scientifique, de normes de publication, d’existence d’un comité de lecture et d’un comité scientifique, de composition de ceux-ci, etc. On comprend bien que la limite de ces critères est d’être, sur un plan, très formels — presque n’importe quelle revue peut arriver à s’en doter sur papier — et, sur un autre, de ne pas pouvoir éviter les jeux de pression, les phénomènes de lobby et les renvois d’ascenseur. Qu’est-ce qui permet de publier dans telle ou telle revue ? La qualité de l’article soumis, sa conformité à l’idéologie sous-jacente ou le réseau de relations et d’appuis de son auteur ? On se gardera de se prononcer. En fait, on est pris à ce propos dans une hésitation entre, d’un côté, le bon sens — établir une liste consensuelle de revues considérées par la communauté scientifique comme présentant des garanties de sérieux suffisantes, et l’afficher — et, d’un autre, la prétention à se parer des couleurs de la science dure, au prix le plus souvent d’une surenchère dont on oublie — les exemples « scientifiques » en sont pourtant nombreux — qu’elle n’offre à terme pas plus de garanties que la « mollesse » qu’elle entend dépasser. Dernier avatar de cette dernière tendance : prendre comme critère des revues « qualifiantes » le fait qu’elles apparaissent dans tel ou tel type d’index. Le problème est ainsi déplacé d’un cran : ce sont les index qui garantissent le sérieux des revues, lesquelles garantissent aux gens qui y publient le sérieux de leurs recherches, lesquelles garantissent aux membres du CNU la valeur des candidats. Quelqu’un a prétendu un jour qu’il n’y avait pas d’Autre de l’Autre … Il est clair qu’il n’a pas été entendu de tous ! Le problème de la critérisation des revues qualifiantes n’est donc toujours pas réglé ainsi ; de plus, quelle indexation va-t-on reconnaître en psychologie ? Les Current Contents, Psychinfo, Medline ? La question, comme je le disais auparavant, a simplement été repoussée, en confiant à d’autres (ou supposés tels) le choix des critères de qualification.
Peut-être est-ce là le fond du problème. Les commissions du CNU reconnaissent, implicitement ou explicitement, n’avoir pas le temps, voire pas les compétences, pour expertiser les recherches des candidats. Ou craignent, si elles s’y risquent, d’entrer dans un débat d’experts qui aurait toutes les chances d’être interminable. Alors elles choisissent de se reposer sur d’autres pour faire cette évaluation — les experts des revues — en les ayant soumis eux-mêmes préalablement à l’expertise du référencement. C’est une vraie logique obsessionnelle qui est ici à l’œuvre ; ce qui est regrettable est qu’elle conduit finalement, d’une part, à ne même plus lire ce que le candidat a produit, puisque de toute façon le jugement qui pourrait en découler ne serait pas reçu par la commission. Et, d’autre part, qu’elle participe d’un véritable processus de stérilisation, en promouvant le conformisme et en privilégiant le respect des pures formes à l’inventivité, voire même au contenu. Je m’explique. Si je veux publier un article, et que je souhaite qu’il soit facilement accepté, j’ai intérêt non seulement à ce qu’il s’inscrive bien dans l’orientation de la revue à laquelle je le propose — et que j’ai soigneusement ciblée auparavant — mais aussi qu’il corresponde étroitement à toutes ses normes. Ce qui veut dire deux choses. Ou je ne publie que dans le petit cercle de mes « amis », et toute la question est évidemment celle de son empan et de sa reconnaissance : si mes « amis » sont puissants, j’ai toutes les chances de le devenir à mon tour. Ou je prends le risque de « l’exogamie », mais alors il faut que je colle au plus près aux valeurs et à la culture de qui je prétends épouser. Ce qui implique la plupart du temps que je ne vais rien apporter de neuf, mais simplement permettre au système de se perpétuer. Un exemple ? J’ai publié il y a quelques années dans le Journal of Clinical Psychology. L’article me paraissait suffisamment lénifiant pour être accepté par une revue américaine, et il avait été traduit par une vraie professionnelle. Il a effectivement été accepté moyennant quelques corrections. Celles-ci en ont entraîné d’autres, plutôt formelles (au fil des navettes, la rédactrice en chef de la revue a d’ailleurs fini par s’étonner qu’on n’ait pas davantage pris la peine de suivre les prescriptions d’un guide, dont nous ignorions jusqu’alors l’existence. Nous l’avons acheté à New York, et découvert un monument de plusieurs centaines de pages expliquant tout — toutes les règles à suivre pour écrire un article formellement inattaquable selon l’idéologie américaine, c’est-à-dire parfaitement « politicaly correct »). Nous avons alors tout fait comme il faut et l’article a été définitivement accepté (quand cela a été le cas, la rédactrice nous a gentiment écrit : « bravo, ça y est ; il n’y a plus maintenant qu’à traduire l’article en américain ! », ce qui suggérait que sa première traduction anglaise n’usait pas du « bon » anglais. Et nous l’avons fait ; nous avons trouvé quelqu’un qui ne fait que cela : retraduire des articles pour les mettre en conformité avec les us considérés). Puis il a été publié et nous en avons été très contents ; la seule chose était qu’il avait été tellement poli qu’il ne restait plus grand chose de son propos original, et que le vif de sa thématique avait été soigneusement arasé.
SM : Des regrets ?
AA : De ce petit épisode ? Non, bien sûr, cela fait quelque chose à raconter. Mais de cette évolution, qui consiste à se vouloir plus « scientifique que le scientifique », en confondant rigueur et chiffrage, en s’alignant sur l’idéologie anglo-saxonne et en stérilisant le contenu de ses propos, parce que ce n’est finalement que lorsqu’on ne dit rien qu’il n’y a rien à y redire, oui, certainement, j’ai des regrets, et plus que cela : des craintes sérieuses quant à l’avenir de notre discipline, et des réserves à mesure !
J’insiste : ce système qui conduit à s’inscrire dans un réseau donné et à être porté par lui, parce qu’on y publie ce qui, a priori, correspond à ce qui est acceptable, ou bien qui veut qu’il n’y ait de valorisé que ce qui est « international », mais en assimilant l’international au label anglo-saxon, est à terme mortifère. Je pense que ce n’est qu’un mauvais moment à passer, et que l’intelligence reprendra ses droits, mais en attendant, c’est toute une discipline qui, croyant ainsi acquérir ses lettres de noblesse — que je trouve pour ma part plutôt douteuses — en paye le prix. Et l’un de ses versants — la psychopathologie — qui s’en trouve particulièrement pénalisé, en grande partie malgré lui, pour des raisons qui lui échappent et en y perdant finalement sa raison d’être.
Qu’on me comprenne bien : qu’on apprécie l’activité d’un candidat par ce qu’il en montre publiquement, c’est-à-dire par ses publications, soit. Et qu’on établisse une liste de supports de publication, comme l’avait fait entre autres l’AEPU (Association des Enseignants de Psychologie à l’Université), qui paraissent raisonnablement sérieux à une partie importante de la communauté scientifique, soit encore. (Ce qui permet de surcroît, en affichant cette liste, de rendre à peu près transparentes les règles du jeu proposé aux candidats.) Mais qu’on sacralise certains critères au nom de la science (qui, justement, reconnaît bien plus de nuances et de complexité à la chose), c’est aussi risible que préjudiciable.
SM : Revenons à la façon dont se passe un recrutement à l’Université. Une fois que l’étape de la qualification a eu lieu, que se passe-t-il ?
AA : Je récapitule : j’ai présenté mon dossier de qualification en décembre et ai appris en février que je suis qualifié (pour 4 ans). Le Journal Officiel publie ensuite la liste des postes vacants, ou susceptibles de l’être, et ouverts au recrutement. Je peux alors candidater à ceux de mon choix courant mars. On examinera mon dossier dans chaque université, me retiendra éventuellement pour une audition et, toujours éventuellement, me classera premier des candidats, ce qui me permettra d’être nommé au poste de cette université au mois de septembre suivant (et par voie de conséquence, d’obtenir le titre correspondant). En tout — et c’est vraiment le meilleur des cas — il m’a fallu un an, à partir de ma soutenance de thèse, pour obtenir un poste dans l’enseignement supérieur.
Pour recruter un candidat, chaque département de chaque université constitue une Commission de Spécialistes (CS) qui correspond à une section du CNU. Cette Commission est, comme le CNU, composée à parité par des professeurs et des maîtres de conférences, élus par l’Assemblée Générale du Département concerné. Certains sont membres du Département, d’autres sont enseignants dans une autre université, afin d’éviter trop d’effets « locaux ». (L’idée est bonne sur papier, mais moins dans la réalité, car nombreux sont les professeurs, par exemple, membres de plusieurs commissions — qui ont toutes lieu presque en même temps —, ce qui entraîne pendant quelques semaines en France une sorte de gigantesque chassé-croisé des candidats et de ceux qui les auditionnent.)
Précisons que les emplois vacants le sont parce que leur titulaire prend sa retraite ou change d’université, ou parce que le poste vient d’être créé ou « redéployé ». (Est plus ou moins utilisée, à l’université, une norme d’encadrement pédagogique, prenant en compte le nombre d’étudiants inscrits dans une discipline, le nombre d’heures d’enseignement délivrées, et le nombre d’enseignants statutaires. Au bout d’un certain temps, il peut arriver qu’un poste devenu vacant dans une discipline qui n’a presque plus d’étudiants soit réaffecté à une autre discipline qui, elle, est peu « encadrée ».) De ce point de vue, rappelons aussi que la psychologie est la discipline qui, en France, a connu la plus grande progression du nombre d’étudiants, ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes, nous allons peut-être y revenir. (Plus de 40 000 étudiants dans l’ensemble des cursus et dans toute la France ; et 3 000 diplômés chaque année, soit le quart des psychologues formés dans toute l’Europe.) Le nombre d’enseignants de psychologie s’est également accru, mais pas en proportion, ce qui peut conduire à des crises sérieuses, comme récemment encore, à l’université de Brest, qui souffre d’un sous-encadrement chronique en psychologie.
Revenons au recrutement. C’est donc le département (ou l’UFR) qui fixe, par votes, un profil de poste, et le transmet à la commission de spécialistes, qui examine alors les dossiers reçus, en retient certains pour auditions et classe les candidats. Ce classement est ensuite avalisé par le Conseil d’Administration de l’université. On a vu récemment — vous comprendrez que ma position institutionnelle me condamne à une certaine réserve — un Conseil d’UFR voter un texte préconisant qu’il n’y ait plus, dans leur université, de recrutements en psychopathologie de candidats témoignant d’une référence à la psychanalyse ! Une mesure aussi discriminatoire a provoqué évidemment un certain tollé, le texte a été en partie amendé (on y parle désormais d’exigence de pluralité des références), mais il est symptomatique d’un mouvement de fond, dont on a observé d’autres manifestations, tout aussi inquiétantes, dans d’autres universités.
(Participe par exemple aussi de ce mouvement — appelons-le par son nom : de chasse à la sorcière psychanalytique, dont témoignent autant Le livre noir que certaine récente expertise de l’INSERM — ce que j’évoquais tout à l’heure : l’arrivée sur le marché de candidats à la maîtrise de conférences, voire au professorat, en psychopathologie, n’ayant aucune expérience clinique, mais un dossier de publications à première vue irréprochable. En fait, si on y réfléchit bien, on s’aperçoit que ce n’est même pas la psychanalyse qui est ainsi visée, mais l’approche clinique dans son ensemble, au profit d’une orientation qu’on qualifie — parfois un peu hâtivement, d’ailleurs — de « cognitivo-comportementale », et qui n’est qu’un mélange d’empirisme réducteur et d’épidémiologie a-théorique et mal pensée.)
J’ajouterai ceci : l’Université est un monde somme toute très paradoxal. Elle se veut démocratique et auto-gérée, et conserve malgré tout des traditions de féodalité affirmée, comme David Lodge s’est malicieusement plu à le souligner. C’est une démocratie auto-gérée : nous édictons une partie de nos règles, élisons des collègues pour les appliquer et exercer la plupart des responsabilités administratives qu’elle implique. Ce n’est pas toujours ce qu’il y a de plus simple et de plus efficace, mais nous y sommes attachés, et convaincus, pour nombre d’entre nous, que les inconvénients ainsi présentés ne sont à tout prendre qu’un moindre mal. Mais c’est aussi une survivance féodale : les départements, les équipes de recherche, correspondent souvent à des formes de « fiefs » où règnent encore volontiers ceux qu’on appelait auparavant des « mandarins ». Même s’ils n’ont plus, souvent, que les oripeaux de leur ancien pouvoir, ils restent directeurs des thèses, et donc de la formation des futurs enseignants-chercheurs, ils sont responsables des axes de recherche des laboratoires, etc. Les incidences en sont réelles ; cela permet de comprendre comment il suffit parfois d’une seule personne pour déterminer pendant un moment — parfois 10 à 20 ans — l’orientation de tout un pôle disciplinaire, et de ce qu’il implique.
SM : Tout ceci a-t-il un rapport avec la récession de la psychanalyse à l’Université ? Et comment expliquer celle-ci ?
AA : La psychanalyse à l’université … Il y a, on le sait, quelques rarissimes — exceptionnels est le mot le plus juste — départements de psychanalyse en France ; il y a aussi de nombreux endroits, et de nombreuses disciplines, où des enseignements sur la psychanalyse, ou qui convoquent la psychanalyse, ont lieu ; et puis il y a les départements, ou les UFR, de psychologie qui comportent un enseignement de psychopathologie, lequel peut être référé en (bonne) partie à la psychanalyse. Compte tenu de l’infléchissement des études de psychiatrie et de la diminution du nombre d’étudiants qui les suivent, c’est là, dans ces cursus de psychopathologie, que se tient le plus grand nombre d’enseignements qui en appellent à la psychanalyse. Je ne parlerai ici que de ceux-ci, dans la simple mesure où ils constituent l’occasion la plus fréquente de rencontre, pour un étudiant, avec la psychanalyse.
Traditionnellement, les études de psychologie, en France, se répartissent en quatre versants (susceptibles eux-mêmes de se subdiviser) : psychologie générale et expérimentale, psychologie de l’enfant, psychologie sociale, et psychologie clinique et pathologique. Ce dernier versant, qui représente habituellement le quart des enseignements de la formation de premier cycle, est pourtant celui qui draine ensuite, dès qu’ils en ont le choix, la grande majorité des étudiants. Ce qui avait d’ailleurs donné lieu à une forme de gentlemen's agreement un peu particulier : les départements de psychologie, à tendance, disons, cognitive, hébergeaient les enseignements de psychopathologie et leur donnaient une sorte de caution et, « en échange », les enseignements de psychopathologie apportaient à la psychologie les effectifs étudiants dont celle-ci avait besoin pour se développer.
Or deux choses sont en train de changer. D’une part, je l’ai déjà évoqué, commence à émerger en France, sur le modèle anglo-saxon, une psychopathologie qui, au mieux, n’a plus de clinique que le nom, et dont les références, pseudo-scientifiques, sont délibérément a-théoriques et fondées sur une conception, disons, mécaniste de l’humain. D’autre part, un certain nombre d’enseignants de psychologie cognitive voient dans cette émergence la possibilité de recycler leurs travaux, de leur trouver de nouveaux champs d’application et de nouveaux débouchés. C’est, pensent-ils, la possibilité d’attirer à eux le flux d’étudiants dont ils étaient privés jusqu’alors, et de se passer ensuite de cet encombrant voisin — les « cliniciens psychopathologues d’obédience psychanalytique ! » —, qui faisait décidément tâche dans le paysage, les déconsidérait sur le plan scientifique et avec lequel il fallait pourtant bien composer. La loi, et ses décrets d’application, sur l’usage du titre de psychothérapeute sont bien sûr un élément supplémentaire dans cette partie : la possibilité de former à bon compte des psychothérapeutes comportementalistes, avec la caution et les moyens de l’université, ne se présente-t-elle pas d’un coup ? Avec tous les avantages qu’elle comporte ? N’est-ce pas un beau rêve, soudain à portée de main ?
Je vais dire les choses très nettement : la psychopathologie, telle que nous l’entendons, telle qu’elle existe actuellement en France — et on peut considérer, à ce titre, qu’elle fait quasiment figure « d’exception culturelle », qui me semble précieuse —, la psychopathologie est en danger. À l’université et, à terme, partout ailleurs. Et avec elle la psychanalyse. Les psychanalystes en sont-ils bien conscients ? Je suis loin d’en être sûr. C’est dommage pour eux. J’ai bien peur qu’ils ne se réveillent un peu tard. Et j’irai encore plus loin : ce n’est pas seulement la psychopathologie et, avec elle, la psychanalyse, qui sont en danger. C’est aussi l’approche clinique dans son ensemble — on s’en rend bien compte en médecine —, c’est-à-dire la prise en compte de la singularité du cas, la prise en compte du « malade » plutôt que de la « maladie », qui est menacée — et, avec elle, une forme d’intelligence des choses qui est battue en brèche.
J’aimerais penser qu’il n’est pas trop tard, que les combats que nous menons ne relèvent pas de la défense des espèces en voie de disparition, que la clinique n’est pas devenue une sorte d’ours polaire en mal de banquise qu’il est urgent de ranimer. Mais n’est-ce pas une illusion de plus ?
SM : Comment cette menace est-elle mise en œuvre, à l’université ?
AA : J’en ai déjà parlé. En psychologie, « l’accord tacite » de partage du territoire entre cognitivistes et cliniciens est remis en question. Par ailleurs, la « féodalité » de l’université implique que des équilibres précaires reposent souvent sur quelques personnes. Il suffit parfois d’un départ à la retraite, d’une mutation et d’une mise en disponibilité pour changer tout un paysage local … On constate depuis deux, trois, ans que le nombre de candidats qualifiés en psychopathologie clinique diminue, que ce soit au niveau maître de conférences ou professeur, et que l’expérience clinique dont peuvent arguer certains de ces candidats diminue elle aussi dangereusement. Les critères de qualification et de recrutement dont j’ai parlé n’y sont bien sûr pas pour rien. C’est toute la formation de nouvelles générations qui est en jeu, mais aussi la transmission de valeurs, de pratiques, d’une éthique. Sur un autre plan, les cursus d’études changent, du fait du passage au LMD, bien sûr, mais aussi du fait de l’évolution générale de l’université, des politiques qu’on y applique. Des projets de numerus clausus sont par exemple à l’étude pour l’entrée en master 1 de psychologie, projets qui, en l’état, et selon les critères qui seront utilisés et les fins recherchées, peuvent paraître particulièrement inquiétants. Enfin, de nouvelles structures se mettent en place : l’ANR (Agence Nationale de la Recherche), l’Agence Nationale de l’Évaluation, les PRES (Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur), qui vont en partie changer les règles du jeu et les enjeux de l’université, et certainement davantage dans le sens d’une promotion des critères high tech dont j’ai déploré les effets pervers, que dans le souci des particularités culturelles et le respect des différences dont nous pouvons aussi nous réclamer.
Face à cela, quels sont nos atouts ? La résistance, façon village gaulois, isolé mais luttant courageusement contre l’envahisseur « c-c » — pardon, contre l’envahisseur romain ? Ou de nouveaux développements, appuyés tant sur nos acquis théoriques et sur notre pratique de l’enseignement, qui continuent à nous attirer l’audience et la confiance de très nombreux étudiants, que sur des alliances avec les praticiens du soin psychique soucieux de ne pas laisser perdre l’héritage clinique qu’ils ont reçu, avec des politiques soucieux de ne pas laisser l’université perdre sa mission publique, avec des scientifiques soucieux de ne pas laisser la science devenir une caricature d’elle-même ?
La réponse s’impose d’elle-même, me semble-t-il. Ce qui laisse présager encore quelques péripéties à venir. Je serai ravi d’en reparler ici avec vous.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sophie Mendelsohn
Alain Abelhauser est psychanalyste et Professeur des Universités (psychopathologie clinique). Il est également second vice-président de l’Université Rennes 2, vice-président du CEVU (Conseil des Études et de la Vie Universitaire) et des formations. Il est, enfin, secrétaire général du SIUEERPP.
Source : Site de l'Oedipe