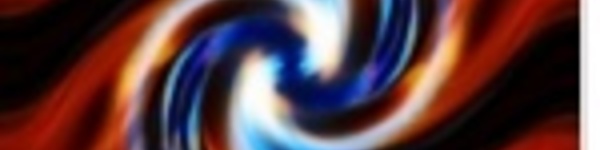L’amendement Accoyer, la psychanalyse et les psychothérapies : une crise complexe*
Pierre-Henri Castel est psychanalyste, membre de l'ALI (Association Lacanienne Internationale), chargé de recherches au CNRS (Philosophie des sciences, IHPST-Université de Paris 1) et chercheur associé au CESAMES (Centre de Recherche Psychotropes, Santé mentale et Société, CNRS-Université de Paris 5)
« Art. L3231 : Les psychothérapies constituent des outils thérapeutiques utilisés dans le traitement des troubles mentaux.
Les différentes catégories de psychothérapies sont fixées par décret du ministre chargé de la santé. Leur mise en œuvre ne peut relever que de médecins psychiatres ou de médecins et psychologues ayant les qualifications professionnelles requises fixées par ce même décret. L'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé [apporte son concours à l'élaboration de ces conditions.
Les professionnels actuellement en activité et non titulaires de ces qualifications, qui mettent en œuvre des psychothérapies depuis plus de cinq ans à la date de promulgation de la présente loi, pourront poursuivre cette activité thérapeutique sous réserve de satisfaire dans les trois années suivant la promulgation de la présente loi à une évaluation de leurs connaissances et pratiques par un jury. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »
Cet amendement au Code de la santé publique, proposé par Bernard Accoyer, député UMP de Haute-Savoie, lui-même médecin, a plongé dans l’ébullition un milieu qui ignorait jusqu’alors qu’il formait aux yeux des pouvoirs publics une cible administrative comme une autre[1] . Une définition légale de la psychothérapie coupe désormais court à la discussion scientifique au nom de la protection d’un public dit « fragile », les psychanalystes détenteurs d’un savoir sophistiqué, culturellement et socialement classant, se retrouvent amalgamés à des « psys » dépourvus de toute caution intellectuelle et historique. Des praticiens chevronnés devraient justifier leur compétence devant des jurys dont personne ne sait de quoi ils seront faits. Pour leur part, les psychothérapeutes informels s’épouvantent de la médicalisation forcée de leur pratique. Ils sont rejoints en cela, quoique pour des motifs incompatibles, par la plupart des psychanalystes ni médecins ni psychologues, mais aussi bien psychiatres, et même universitaires, investis de longue date dans les soins mentaux, et qui tiennent à disjoindre la dynamique de la cure de tout bénéfice thérapeutique (soutenant en bonne orthodoxie que cette disjonction est au principe de l’efficacité durable de leur action). En tiers, enfin, les tenants des thérapies cognitivo-comportementales (TCC), déjà médicalisées, et calculées précisément pour répondre aux critères psychométriques qui satisfont aux impératifs de gestion de la santé (mentale ou pas), se réjouissaient, pour citer un forum sur Internet, qu’on « fasse enfin sortir le loup du bois ».
A l’arrière-plan, enfin, se profilent aussi d’autres enjeux. Les psychothérapies seront-elles remboursées ? Sur quelles bases ? Y aura-t-il protection du titre ? Ou un délit d’exercice illégal de la psychothérapie ? Pourra-t-on poursuivre un thérapeute pour faute ? Quelle part sera dévolue à l’université dans leur formation ? Quelle autre (si on leur en concède une !) aux instituts privés ? Sur quels critères les homologuer ? Question enfin extrêmement grave et qui ne paraît pas avoir reçu l’attention méritée, comment leur fonctionnement sera-t-il altéré, avec quels effets, non seulement sur la liberté de pensée de leurs membres, désormais dépendants comme jamais de leurs instances, mais même sur l’authenticité de leur démarche ?
Les adversaires de l’amendement, emmenés de moins en moins par les représentants d’associations de psychothérapeutes informels et de plus en plus par Jacques-Alain Miller, ont donc éprouvé un vif soulagement devant le recul de Bernard Accoyer, lequel affirme aujourd’hui, face au tollé, ne plus vouloir encadrer que ce qu’il appelle « psychothérapies lourdes », laisser ceux qu’elles ne concernent pas (censés non-malades ?) « voir qui leur chante » et surtout, exclure la psychanalyse du champ de cette réglementation[2] .
Soulagement à mon avis trompeur, et je dirai pourquoi.
Mais il reste à mieux saisir la nature de la réponse apportée par le milieu « psy » à ces défis, qui a été, et qui reste à ce jour, je le dis sans intention péjorative, corporatiste (car il y va de la survie de milliers d’acteurs), puis à proposer une lecture distanciée de ce phénomène, disons, à partir des années 80 — lecture qui, je l’espère, permettrait de suggérer quelques coups justes à jouer dans une partie compliquée, et qui n’est nullement achevée. Or ces coups justes, vais-je soutenir, sont plus des questions empiriques à poser (auxquelles il faudrait se donner les moyens de répondre) et bien moins des solutions à des difficultés dont on fait état comme d’évidences (la protection du public fragile en est une), mais dont une bonne partie sont parfaitement imaginaires, ou bien entièrement conjecturales.
« Les » psychothérapies, de la façon la plus englobante possible, englobent l’ensemble des réponses données par des professionnels ou des semi-professionnels à des demandes de soins psychologiques (ou du moins, vécus ou auto-catégorisés comme « psychologiques »). Elles vont du « travail sur soi » utilitaire (à la limite de la simple prise de conscience dans la recherche de performances au travail, dans le couple) à la gestion de malaises infra-cliniques que les clients ne tiennent pas à médicaliser, les psychothérapies ayant alors des accointances avec les « médecines douces [3] . Puis, et l’on franchi là un seuil crucial, elles s’adressent aux états « névrotiques », qui sont spécifiquement pris en charge par les « psychothérapies psychanalytiques », ou bien alors aux symptômes pris un à un comme cibles, sans exploration personnelle fouillée (objets privilégiés des thérapies cognitivo-comportementales : TCC). On passe de là aux prises en charge au long cours de pathologies chroniques, exigeant un soutien constant et une surveillance avertie (de l’alcoolisme à la schizophrénie), que de moins en moins de psychiatres ont les moyens matériels d’assumer en libéral ou dans le public, mais qui relèvent de leurs attributions Et l’on arrive enfin à la psychanalyse stricto sensu, occupant le pôle opposé mais symétrique du plus bas degré de la psychothérapie, puisqu’elle propose moins un travail sur soi, qu’une élucidation (partielle) du labeur que l’autre (mon semblable, mon déplaisant « prochain », mon partenaire sexuel, voire mon monde social et sa langue) impose à chacun. Mais cette élucidation est indirectement thérapeutique (guérir est l’effet, non le but). Offrant à l’individu moderne une de ses dernières grandes aventures intérieures, elle est enfin valorisée par la haute culture comme un lieu d’exception.
Si l’on ne veut pas sombrer dans le débat préalable de savoir si la psychanalyse est ou pas une psychothérapie, ou si les psychothérapies doivent ou non être médicalisées, il suffit, j’insiste, de partir du fait de la demande de soins psychologiques : de quelque façon subtile ou prudente que le destinataire de cette demande se représente ce qu’il fait, c’est à ce titre, et à ce titre seul, qu’il sera traité en psychothérapeute — et, ajouterai-je, que cela lui plaise ou non. En un mot, peu importe désormais que le mot « soin » figure dans une demande comme : « Soignez la maladie dont je souffre ! », ou dans cette autre, désormais essentiellement analogue dans nos sociétés : « Prenez soin de moi ! ». Le temps n’est plus ou le caractère très articulé et hiérarchisé conceptuellement de l’offre de soin permettait encore de dire, pour citer Lacan, qu’une psychanalyse, c’est ce qu’on demande à un psychanalyste : on travaille (surtout quand on est débutant) à la rigueur en psychanalyste avec la souffrance psychique, mais les patients découvrent souvent au fur et à mesure la technique propre à ceux qu’ils consultent, et de toutes façons, la prodigieuse extension de la culture psychologique à tellement abrasé les différences entre les méthodes, aux yeux du public comme des acteurs de la santé mentale, que fort nombreux sont les éclectiques, qui conjuguent psychothérapie psychanalytique, TCC, hypnose, et parfois avec le même patient.
Conformément aux prédictions de Robert Castel[4] , la norme ultime de tout traitement psychothérapeutique, qui a été dans les faits la psychanalyse jusqu’aux années 80, est donc devenue la triste victime de son succès. A mesure que s’incorporaient aux discours quotidiens les idéaux « relationnels », une certaine attention à l’enfance comme l’âge à scruter où toute la vie future se déciderait, dans la mesure aussi où la sexualité épanouie est revendiquée comme un lointain héritage freudien, ou que la lecture « oedipienne » des liens familiaux envahit les médias, tandis enfin que des mots comme « refoulement » n’ont plus besoin de légitimation théorique, plus rien ne permet de parer à la vulgarisation-dépréciation de la psychanalyse. Sa capacité à en imposer, point décisif que masque en ce moment un pur succès de lobbying, par l’autorité liée à sa difficulté intrinsèque, s’est définitivement émoussée. Les thérapeutes non-psychanalystes savent en effet que ce qu’ils offrent n’arrive pas à la cheville des productions freudiennes ; cela ne les intimide plus, et ils en font même un argument pour s’approprier des formes de malaises psychologiques plus diffus qui ne justifieraient pas d’une démarche aussi longue et coûteuse qu’une cure[5] . C’est ce double effet (1. caractérisation de la psychothérapie par le fait social massif d’une demande indistincte de soins psychologiques, et 2. ruine du paradigme de la psychanalyse comme norme des autres thérapies de type relationnel) qui a abouti à la situation présente.
Tout cela rend presque illisible le chiffre considérable des personnes ayant suivi en France une psychothérapie, comme le jugement globalement favorable qu’elles expriment. Il y aurait eu ainsi environ 800000 personnes de plus de 15 ans en psychothérapie en 2001, soit 1,7% de la population, sans compter les enfants qui sont de gros consommateurs (on ajoute alors, Dieu sait pourquoi, 200000 au premier chiffre), et, en incluant cette fois ceux qui ont dans le passé eu recours à ce type de soins, 5,2% de la population générale, soit 3 millions d’individus concernés (avec les enfants, qu’on ajoute selon les mêmes obscurs critères). Ces chiffres ont été obtenus par sondage sur 8069 adultes ventilés selon la méthode des quotas par l’institut BVA, d’une part, et, d’autre part, réexaminés à la lumière d’une enquête en ligne du magazine Psychologie [6] , dont la méthodologie ressemblait fort à la méthode controversée de l’enquête américaine du Consumer Report de 1995, laquelle avait donné lieu à des études statistiques fouillées, mais peu concluante[7] . Curieusement, le taux de satisfaction dans les deux enquêtes françaises est identique (84%)…
Mais que valent ces impressionnantes données numériques ?
Pas grand-chose. Car, comme ce sondage a été suffisamment bien conçu pour estimer le niveau d’information des répondeurs, on y découvre que plus de 40% ignore la méthode qui leur a été appliquée — quand ils n’appellent pas psychothérapie les 15 minutes bimensuelles chez le médecin qui renouvelle leur ordonnance de psychotropes. De plus, la confusion entre psychothérapeute, psychiatre, psychologue ou psychanalyste y est courante. A supposer, ensuite, qu’il y ait entre 12 et 30% de personnes « en analyse » (selon l’inclusion ou pas des « psychothérapies d’inspiration psychanalytique » dans l’échantillon), presque 60% des « analysés » (car la plupart semblent considérer avoir fait une psychanalyse, aurait-elle duré six mois) sont incapables d’identifier l’école dont relève leur psychanalyste. Plus cocasse, est fréquemment considérée « thérapie de couple » une thérapie où l’on parle de son conjoint, pas celle où l’on se rend en sa compagnie. On pourrait se consoler avec le public mieux informé de Psychologie, notre seconde source. Mais si les titres des psychothérapies y sont mieux repérés, surtout s’il s’agit des psychothérapies humanistes (rogériennes, psycho-corporelles, etc.), les bizarreries n’y sont pas moindres. Ainsi, dans ce second échantillon (nullement représentatif, lui, comme l’échantillon sondé par BVA), 40 % des patients seraient censément « en analyse », ce qui se ventilerait : 20% d’analyse freudienne, 7% de lacanienne, 4% de jungienne et 0,5 % de kleinienne, le reste, soit 9,5%, étant défini par les intéressés comme de la « psychothérapie analytique ». Je passe sur la qualité des antennes nécessaires à la détection des qualités lacaniennes ou freudiennes du silence (au moelleux du divan ?), pour m’étonner de la place minime des psychothérapies psychanalytiques. Comment peuvent-elles ne compter que pour 25% des analyses ? Leur rythme plus lent (en France 2 à 3 séances par semaine), et la disposition en face-à-face les rendent, de l’avis général, plus courantes que la cure standard[8] . Si la psychanalyse, dans ce public présumé mieux informé, est soumise à de pareilles distorsions d’image, aussi improbables au vu des inquiétudes actuelles des praticiens, on se demande par contrecoup ce qui a été saisi dans les autres cas. Quand à ce que déclarent les psychiatres libéraux, sur lesquels on dispose d’une enquête de 1994 du Syndicat des Psychiatres Français, et qui tous ou presque se déclarent psychothérapeutes, si 60% se réfèrent à la psychanalyse et le reste à « rien de spécifique », la moitié déclarait pratiquer la psychanalyse (à raison de séances d’une demi-heure au moins), un sixième les TCC, ou l’hypnose, ou les thérapies familiales (exemple du syncrétisme actuel) et un sixième encore la relaxation[9] .
Tout n’est pas ici nécessairement erroné. Si chaque psychothérapeute reçoit environ 60 patients par an, toutes techniques confondues, ce qui paraît raisonnable, on retrouve par une règle de trois à peu près les 10 à 15000 praticiens censés exercer en France[10] . Mais en divisant quelque chose par quelque chose, on finit toujours par retrouver quelque chose. Autant dire que le besoin d’accorder entre eux ces chiffres est criant, et qu’un sondage ou une enquête en ligne sont loin du degré de précision requis pour éclairer des décisions de l’importance de l’amendement Accoyer.
En fait, la mise en scène de ces chiffres donne leur véritable sens. Dans un exposé aux Etats-Généraux de la Psychothérapie en mai 2001, Serge Ginger, Gestalt-thérapeute militant pour un statut des psychothérapeutes (aujourd’hui catastrophé du tour restrictif que lui donnait l’amendement Accoyer), les ponctue de détails plutôt malaisés à relever dans la pluie des statistiques, mais qui touchent juste : après une psychothérapie, dit-il, la consommation de psychotropes baisserait considérablement (d’un tiers pendant la thérapie, pour chuter à 5% après, selon les répondeurs en ligne de Psychologie). Il est certain qu’il s’agit d’un poste de dépense élevé pour la sécurité sociale ; l’intention est donc transparente. Mais il n’est pas sûr que les consommateurs de psychotropes distinguent clairement anti-dépresseurs, hypnotiques, benzodiazépines, neuroleptiques et régulateurs de l’humeur, et peut-être même toutes ces substances d’autres, qui ne sont pas des psychotropes du tout. D’autre part, comme il est crucial de monter en épingle la relation des Français aux psychothérapeutes (qui est quatre fois moindre qu’aux États-Unis, où, il est vrai, le conseil spirituel occupe une grande place), il ajoute : « Lorsqu’on admet que l’impact d’une psychothérapie touche directement les proches (conjoint, parents, enfants), on voit de suite qu’en réalité, la psychothérapie concerne, plus ou moins directement, près de huit millions de Français »[11] . Ce style de commentaire pseudo-sociologique n’est nullement exceptionnel, et s’il n’est peut-être pas faux, il est aussi important de souligner qu’il n’existe aucun moyen, aujourd’hui, de savoir en quoi.
On ne peut en tout cas tirer de ces indications, et je veux commencer par insister sur ce point, rien qui alimente aucune position, quelle qu’elle soit, tellement elles sont ployables à toutes les rhétoriques, et peuvent alimenter toutes les peurs absurdes comme toutes les méconnaissances dangereuses. C’est là un vaste chantier qui s’ouvre, dont on ne peut prédire quels résultats il va produire, mais dont l’urgence est patente.
*
La vraie difficulté est donc qualitative. On ne peut lancer une étude sans savoir quelles questions poser à quel objet, dans quel but, dans quel contexte, avec quels moyens statistiques, et pour vérifier quelles hypothèses. Or sur la voie des bonnes définitions comme des bonnes questions, on rencontre toute une série d’obstacles.
Certains sont connus.
On dénombrerait, dit-on, au moins 400 formes de psychothérapies. De fait, détecter l’intrus dans la liste suivante deviendra peut-être un jour un grand jeu de société : bio-énergie, psychosynthèse, Gestalt-thérapie, sophrologie, programmation neuro-linguistique (confondue par erreur avec le conditionnement neuro-associatif), analyse transactionnelle, bio-analyse, somatothérapie, psychothérapie corporelle intégrée, étiopsychologie, relaxologie, co-conseil, cri primal, rebirth ou bio-respiration, thérapie client-centered, rolfing, andragogie, kinésiologie, sophia-analyse, stratégie de vie, sans oublier healers, praticiens de la relation d’aide, graphométriciens, agents d’intervention de crise et médiateurs ethnocliniciens [12] . Non seulement plusieurs d’entre elles sont interchangeables, mais leur efficacité spécifique dépend explicitement de facteurs comme la personnalité du praticien et du groupe qu’il structure autour de lui. Ces groupes, pour ce qu’on a pu apprécier aux Etats-Unis (les études plus récentes et plus françaises manquent cruellement), se font et se défont avec rapidité. Tous prônent un éclectisme consolidé par la récusation des sociabilités conventionnelles et de tout intellectualisme[13] . Mais les versions les plus récentes ne manquent pas de cautions de respectabilité : une société savante internationale, un journal (avec comité de lecture, peer-reviewing, etc.), des programmes de formation longs et standardisés. De telles « références » servent, je suppose, à intimider les bureaucrates, mais leur contenu scientifique n’engage, pour le moment, que leus lecteurs. (Je mets à part, pour y revenir, les pratiques dont l’effet psychothérapeutique est officiellement marginal, comme les spiritualités inspirées de l’Orient, ou la dégénérescence de la vieille psychologie industrielle autoritaire, au service des patrons rationnels des années 50, en « développement personnel » autogéré.)
Mais d’autres obstacles à une réflexion sérieuse sont moins apparents.
J’en vois en fait quatre :
1. l’« imaginaire professionnel », pour citer Robert Castel, des psychanalystes ;
2. les fantasmes des « usagers » (et sur les usagers), avec tout ce qu’un principe de précaution généralisé entraînerait de contre-productif ;
3. Les réticences de l’establishment médico-psychologique, qui pourrait être entraîné plus loin qu’il ne souhaite si l’on posait à fond la question des psychothérapies ;
4. Les carences de l’expertise sociologique depuis les années 80 — que je traiterai à part.
Les interventions de Jacques-Alain Miller dans la presse illustrent le premier point [14] ; elles témoignent avant tout de la certitude des psychanalystes d’avoir raison sur des questions où, jugent-ils, leur discipline, son histoire, voire son épistémologie, leur garantit la position de surplomb qui devrait en faire les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics. Il n’y a qu’un inconvénient. C’est qu’on peut avoir raison et se faire politiquement balayer. Comprendre ce fait tout simple suscite dans les discussions qui bruissent dans le milieu une réaction bien révélatrice : chacun rappelle avec force son attachement à ses principes de non-ingérence de l’Etat, ou son refus de la médecine mentale « objectiviste », comme si ce rappel, transcendant la crispation personnelle qu’il reflète (et il y a de quoi, assurément, se faire du souci, pour soi et pour ses patients !) allait miraculeusement réveiller une conscience collective endormie. Bien des psychanalystes comprennent aujourd’hui que si la psychanalyse a bénéficié d’une pareille immunité en France, ce n’était pas du fait de sa structure interne, ni de sa logique du sujet, ni du rapport quasiment hors-social qu’elle instituait par son abstention de principe à l’égard de ce qui est dit (sur le divan), ni par son prestige culturel repoussant avec tranquillité toute mise en cause, mais aussi, peut-être surtout, parce qu’elle profitait de niches juridiques, économiques, sociologiques, politiques, culturelles, dont la relative inertie a été confondue avec une promesse d’éternité. Seuls, semble-t-il, ceux qui ont été mêlés à l’évolution des hôpitaux psychiatriques, et qui ont mesuré la vanité des arguments cliniques quand il s’agit de « rationaliser les soins », ont senti le vent venir. La plénitude d’existence que procurait le statut de psychanalyste, livrant à la fois des clés fascinantes pour déchiffrer les agressions d’un monde extérieur qui nie souvent l’inconscient, avec les moyens financiers d’une passion unique, en résonance avec la haute culture, mais offrant aussi la sécurité non-négligeable de postures où des notables installés, aux commandes d’appareils considérables, peuvent se vivre eux-mêmes en même temps, fort sincèrement, comme des personnages subversifs, savants maudits par leurs pair, ou défenseurs héroïques de valeurs universelles mais « universellement refoulées » — voilà ce qui a obscurci la teneur des essais méritoires de sauver ce qui devait l’être. Car ces postures n’exercent plus l’effet puissant qui a été le leur jusqu’à la mort de Lacan ; elles continuent à captiver le petit peuple de la psychanalyse, et, par nostalgie, une frange vieillissante de l’intelligentsia. Mais ces propos acerbes, seraient-ils drôles et pertinents en leur fond, sont désormais prisonniers de la bulle « psy », et ne mordent plus sur le monde[15] . En somme, l’imaginaire professionnel des psychanalystes les menace de voir leurs efforts (efforts légitimes, qu’on m’entende bien), faute d’écho efficace, se réduire à des gesticulations corporatistes, souillées d’alliances circonstancielles et contre-nature, avec le risque accru de se révéler aux yeux de leurs vieux rivaux positivistes comme la caste faillie qu’on va enfin déboulonner de son socle. La psychanalyse a commencé ; elle pourrait aussi finir.
Les fantasmes des usagers, ou plus exactement les fantasmes qu’on construit à l’usage des usagers, dans une opération de captation intéressée de la fonction du porte-parole, sont un second obstacle à déblayer. On peut être franchement consterné du procédé. Que dire, par exemple, des glissements successifs par lesquels Françoise Sironi, dans un article récent[16] , en vient à supposer qu’il faut un statut des psychothérapeutes pour prévenir les abus sexuels sur les patients ? En quoi, grands dieux, un tel statut changerait-il quoi que ce soit ? Comme si leur niveau universitaire avait jamais empêché des sexologues, médecins éminents, couverts de titres, de se faire poursuivre devant les tribunaux pour viol, comme si le crime n’exploitait pas tous les moyens honorables, justice, secours aux enfants, que sais-je encore, précisément pour se perpétrer. Va-t-on pour autant interdire la médecine, les magistrats, les associations d’accueil aux enfants ? Malheureusement, il n’existe pas de lois contre les gens qui ne respectent pas les lois. Il y a des lois, c’est tout. La seule chose qui pourrait empêcher le non-respect de la loi, ce serait de la remplacer par des prescriptions obligatoires, contrôlées à tout instant ; c’est le totalitarisme, et il est évidemment incompatible avec les prémisses de Sironi. Celle-ci prétend alors que ces abus sont suffisamment fréquents pour justifier l’intervention urgente des pouvoirs publics. Sur quelles bases ? On ne sait même pas, je l’ai dit, combien il y a de psychothérapeutes en France, ni en quoi l’échantillon de « victimes de sectes » auquel elle joint celui des « victimes de psychothérapies » auto-proclamées (et l’on a vu quoi penser des capacités des gens à discriminer ce qui est une psychothérapie et ce qui ne l’est pas) serait représentatif de quoi que ce soit. Pour relire ensuite le cas qu’elle offre, celui de la religieuse violée, il est lui-même obscur (le « développement personnel » est-il une psychothérapie ? En quoi s’agissait-il d’ailleurs de « développement personnel » plutôt que de n’importe quel happening ? Est-ce donc la psychothérapie supposée elle-même qui est en cause, et non la fraude, ou l’usurpation de titre ? En quoi enfin ce viol n’est-il pas un viol par séduction ordinaire, qui aurait pu se passer avec ce thérapeute comme avec un prêtre ?). J’insiste sur le caractère naïf de ces questions. Le point frappant, c’est que Sironi en tient les réponses pour si évidentes, qu’elle ne songe pas un instant qu’un contre-exemple à l’irénisme de Jacques-Alain Miller, son adversaire, ne prouve pas qu’il se trompe. Mais on a deviné ce qui se passe : c’est que le lieu d’où elle parle, d’où elle vise la psychanalyse comme un obstacle à la salutaire régulation des psychothérapies, est un lieu d’élaboration théorique antagoniste, qui veut faire reconnaître sa supériorité : on y promeut une technique psychodynamique anti-freudienne, imprégnée d’ethnopsychiatrie, et qui prend au sérieux la problématique de la Trauma Theory. Je vais y revenir, mais on peut déjà la réduire en gros à cette idée qu’il y a des traumatismes réels (et non fantasmés, comme le soutenait Freud). La cure par la parole est alors incriminée comme une pratique de quasi « tortionnaire », dans la mesure où elle donne au traumatisme un doublon psychique, à verbaliser impérativement. Le tour particulier que lui donne Sironi, c’est qu’en enracinant ces traumatismes réels dans un contexte politique, elle entend créditer par ricochet les usagers qui se plaignent (ou se plaindraient) d’une vertu civique. Ce ne sont pas des « naïfs », encore moins des névrosés qui fantasment, mais l’extension contemporaine de cette vaste masse de femmes effectivement martyrisées qui ont renversé politiquement les diagnostics d’hystérie et d’autosuggestion où la psychanalyse les enfermait.
Laissons de côté le débat doctrinal. Car, paradoxalement, de telles conjectures révèlent surtout l’extraordinaire mépris qu’on voue au dit sujet « politique », comme au sujet du droit. Déjà, l’exposé sommaire qui précède l’amendement Accoyer contenait les propos suivants : « [les psychothérapies prétendues] peuvent faire courir de graves dangers à des patients qui, par définition, sont vulnérables et risquent de voir leur détresse ou leur pathologie aggravée. Elles connaissent parfois des dérives graves. Depuis février 2000, la mission interministérielle de lutte contre les sectes signale que certaines techniques psychothérapiques sont un outil au service de l’infiltration sectaire et elle recommande régulièrement aux autorités sanitaires de cadrer ces pratiques. » Or, comment ne pas voir que si on ne commence pas par supposer assez de bon sens à une personne qui souffre psychiquement pour distinguer le violeur du thérapeute, il n’y aura pas de limites au réseau de protections dont il faudra l’entourer ? Non seulement il n’existe pas de loi contre ceux qui enfreignent la loi, uniquement des peines, mais les lois ne peuvent pas être rédigées pour ceux qui ne sont pas raisonnables. Et on peut souffrir psychiquement et être raisonnable. Ou alors, disons les patients mineurs jusqu’au bout, et prenons sur nous de porter plainte contre leurs thérapeutes, même s’ils s’en estimaient contents — pauvres victimes inconscientes à protéger de leur inconscience ! Du cas particulier (tel abus), on ne peut justement pas aller au cas général sans détruire ici ce qui fait du cadre un cadre légal. Mais l’arsenal juridique pour punir existe : il suffit de juger pour escroquerie, viol, etc. Dans ce système ambigu, où l’on mobilise de la main droite l’usager-citoyen en lui imputant de la main gauche une faiblesse psychique disqualifiante, nul doute que les experts vont proliférer, capable de discriminer les seuils inscrutables, voire, comme Sironi, d’écarter à coup sûr les effets (si évidents) d’un « transfert négatif »[17] . Or c’est en toute franchise que Sironi se place sous le patronage du Centre Georges Devereux, et qu’elle tient pour naturel de glisser des sectes aux psychothérapies. Il n’en est pas moins entièrement conjectural qu’on puisse empiriquement lier psychothérapies et sectes, ou parler d’abus majeurs liés aux psychothérapies en tant que telles. Il n’est pas exclu qu’un tel lien soit établi un jour ; mais pour le moment, qui s’en est donné les moyens ?[18] . Ce qui donc émerge du débat, c’est plutôt la mise en forme militante de ce que je ne crains pas, jusqu’à preuve du contraire, d’appeler des « fantasmes d’usagers » : où se dessine en creux une figure normative nouvelle de ce que les gens devraient attendre de leurs psychothérapies (pour ne pas être dupés), où s’esquisse aussi la mise sous tutelle soft d’aspirations intimes. Bien sûr, tout cela ne fait pas partie du programme politique de Sironi ; elle l’a prouvé par d’autres travaux[19] . Mais c’est en quoi son article est exemplaire : il fraye la voie au strict contraire de ce à quoi elle aspire. Malheureusement, le contexte sécuritaire du débat sur la santé mentale laisse présager le pire, tant l’image des abus dans les médias tend à recouvrir leur proportion dans des ensembles sociaux déjà lourdement régulés.
Les réticences de l’establishment médico-psychologique à un traitement radical de la question des psychothérapies sont, je suppose, encore un autre obstacle méconnu à la simple formulation des bonnes questions. Une mauvaise conscience certaine envahit depuis peu les hôpitaux universitaires. Sans doute, l’idéologie majoritaire soutient encore que le psychiatre est ès-qualité psychothérapeute (puisque la psychothérapie qualifie un acte médical, et qu’un interne est censé l’avoir appris durant les stages pratiques). Mais on voit s’ouvrir depuis 2000, à gauche et à droite, dans les facultés de médecine, sur le modèle du Diplôme Universitaire de Lyon, des DU de psychothérapie, pour lesquels se trouvent assez miraculeusement des fonds et des enseignants. On est loin encore de se demander si le modèle suisse ne serait pas le bon, où le psychiatre doit par principe se former dans un organisme extérieur, conventionné par les cantons, à une technique qui implique un « travail personnel » (la psychanalyse, mais pas seulement). Toutefois, en France, coexiste avec la confiance dans le titre de psychiatre les restes de la période ancienne, où il était clair, précisément parce qu’on était psychiatre, qu’il fallait faire en plus une démarche personnelle (idéalement une analyse). Dans des hôpitaux du cadre, à la différence des hôpitaux universitaires, une petite pression continue, semble-t-il, à s’exercer dans ce sens. Or un mouvement de ce type serait peut-être en train de renaître, à la faveur d’une modification insensible des attentes de jeunes internes davantage demandeurs de recherches psychologiques[20] .
Or, là encore, les enjeux sont complexes. Le rapport Pichot-Allilaire de 2003, de façon transparente, conçoit la psychothérapie comme un acte complémentaire de la prescription de psychotropes. Il en ressort que la psychothérapie en elle-même, si elle est pratiquée à part par un psychologue, ne saurait en son fond valoir que sous la tutelle du médecin prescripteur, qui devrait rester aussi l’évaluateur. Ce rapport reflète des soucis venus des Etats-Unis : les enquêtes attribuent toujours la palme de l’efficacité aux thérapies combinées (psychotropes et TCC), mais les assurances remboursent les médicaments, pas le suivi psychologique, alors qu’il est raisonnable de penser que le jeu en vaudrait la chandelle. D’où le souci des autorités médicales de protéger le label « psychothérapie » de l’invasion par des pratiques informelles, non seulement parce que le statut du psychiatre en tant que vrai thérapeute de l’esprit serait dégradé, ou du moins banalisé, mais aussi parce que les maladies psychiques ne peuvent pas devenir aussi informes que ces malaises diffus à quoi s’adressent les thérapies informelles : la dépression dite « résistante », les troubles obsessionnels-compulsifs, les phobies, voilà du dur. Le mou, ce sont les deuils transitoires, les dépressions qui cèdent sous placebo, etc. La pente sociale à instrumentaliser les psychiatres comme des religieuses laïques au secours de troubles fluctuants hérisse notoirement la profession, qui ne s’intéresse au tabagisme que si c’est une addiction, ou aux malheurs de la vie que dans le cadre du stress post-traumatique constitué. Ces inquiétudes motivent la pression médicale pour réglementer les psychothérapies. C’est un renforcement indirect du périmètre de l’exercice légitime de la médecine mentale, qui soigne des maladies qui sont de vraies maladies. Entre les compétences neurobiologiques qui font le prestige des hiérarques, et le tout-venant de la misère hospitalière et extra-hospitalière, la zone intermédiaire indécise exige des défenses solides. D’un autre côté, on aurait tort de croire les professeurs acquis unilatéralement aux neurosciences ; la nostalgie de la vieille clinique les hante encore. Pourvu qu’elles offrent des garanties de sélection, les écoles de psychanalyse huppées et orthodoxes n’ont pas perdu la bataille. Mais ce tropisme compréhensible des mandarins risque de se heurter à une autre contrainte, qu’on a perdue de vue dans les débats d’après l’amendement Accoyer alors qu’elle était au cœur des soucis dans la discussion qui l’a précédé. Car si l’on déshospitalise en masse (fermeture de lits, substitution de nouveaux neuroleptiques moins sédatifs aux anciens, gros efforts de réinsertion sociale, collaboration avec les familles, les associations, etc.), il n’en reste pas moins que les files actives des CMP (Centres Médico-Psychologiques), qui sont comme les bassins de refoulement des pavillons fermés des asiles, tendent désormais vers l’infini. Il faut donc assurer des soins hors-hôpital à une cadence infernale. Des psychothérapeutes accrédités désengorgeraient le système. Il est clair toutefois, qu’il en faudra plus que l’élite choisie des grandes sociétés de psychanalyse. Il faudra faire des compromis.
Mais il n’est pas sûr que les TCC puissent entièrement prendre en charge ce champ, dans la mesure où, dans la nature, et non plus en laboratoire, les supériorités vantées de ce modèle sur les psychothérapies dynamiques (psychanalytiques, surtout), fondent comme neige au soleil, sous la pression de la demande des patients, toujours plus complexe que prévue, et de l’ethos particulier qu’exige le suivi au long cours de malades chroniques[21] .
Du côté des professeurs de psychologie, la même supposition prévaut que le diplôme de psychologue-clinicien devrait suffire (tellement les stages mettent les étudiants au contact de patients et de superviseurs expérimentés). De même, survit la pratique de la démarche personnelle hors du cadre universitaire, du fait même qu’on est psychologue, et sans qu’elle soit imposée par autre chose que l’idéalisation du rôle à jouer. Or le fait est qu’il n’y a pas de formation à la psychothérapie à l’université.
Avouant à demi-mot la difficulté à laquelle l’acculent certains psychothérapeutes militants (qui invoquent des « formations » aux délais ahurissants : des années pour apprendre la bio-énergie !), Roland Gori a fait circuler un projet de refonte des cursus parant la critique[22] . Il veut prendre à contre-pied ce que Françoise Champion appelle les « psychothérapeutes non-académiques » (car ils peuvent être diplômés, ce qu’ils font n’est pas légitimé par l’université). Bien documenté, ce rapport compare les programmes universitaires européens, afin de ne pas compromettre le pilier de l’institution psychologique en France, la loi de 1985, qui protège le titre de ses diplômés[23] . Il suggère de spécialiser certains psychologues par un renforcement de leur expérience clinique, avec deux idées en tête : pallier « la pénurie de psychiatre » (alors que la France a un taux de psychiatres par habitants des plus hauts du monde), et répondre aux demandes de soins plus informelles, en protégeant le public des charlatans. Puis Gori réclame, en échange des efforts, des postes pour les psychologues ainsi formés. Qui peut croire que de tels postes ne conduiraient pas à des statuts les protégeant ?
La critique du modèle subordonné de psychothérapie (un supplément aux psychotropes) est également très nette. Il est hors de question de céder sur le privilège des psychologues, garanti en 1985, de faire des diagnostics et de participer aux soins de façon autonome — ce qui est, notez bien, en contradiction avec l’article L372 du Code de la santé publique, qui fait de tels actes un exercice illégal de la médecine.
Or, tout cela rend pressant « le » problème : comment ne pas diluer la psychologie comme science ? Comment éviter l’inscription fatale des psychologues dans le Code de la santé publique au titre IV des « professions de santé », en compagnie des sages-femmes et des dentistes, avec sa réduction à une simple technique et la subordination aux médecins qui en découle aussitôt ? En la divisant en spécialités, comme la médecine — et implicitement, à parité, propose Gori. Sans que les choses soient si claires, son propos suggère néanmoins que les psychothérapeutes dûment formés seraient comme des psychiatres-sans-médicaments, sans que ce soit une déficience plus grave que d’être cardiologue sans rien savoir du cancer du foie. La querelle des psychothérapeutes, on le voit, est ici l’occasion « d’aller plus loin », dit Gori : en fait de relancer la guerre avec les psychiatres (encore que les deux clans s’entendent pour dénier aux généralistes la moindre compétence psychothérapeutique !). Mais une part de son argument consiste alors à retourner contre la psychiatrie sa crainte d’être débordée par des demandes impossibles à satisfaire, d’origine sociale, ou pire, politique, qui prendrait la forme gênante de symptômes mentaux sous-déterminés : aux psychothérapeutes de prendre ces mal-être en charge, pour prévenir, contre les effets pervers du paradigme objectiviste et donc impersonnel de la médecine scientifique, toutes les frustrations dont font état les malades, au point de porter leurs griefs en justice. On ne saurait mieux offrir une solution clé en main au malaise social, au moyen de ce qui est, quoi qu’on dise, une offre « technoscientifique » des psychologues. La prédiction de Robert Castel touchant les psychologues des années 80 se réalise : « la présence de cette masse de qualification sans emplois pousse à la création d’emplois correspondant aux qualifications, et contribue ainsi au développement du champ médico-psychologique et médico-social »[24] . Or les psychologues ont-ils les moyens de jouer ce rôle de charnière ?
J’aimerais savoir, pour mentionner le rôle envisagé de tampon entre les sujets et la technostructure médicale, ce qui protégerait les protecteurs, et qui bloquerait la judiciarisation des actes psychothérapeutiques censés anticiper la judiciarisation des actes médicaux... Sans compter le décalage suspect entre le discours humaniste, anti-scientiste, et l’offre plus tactique d’un pansement psychosocial là où ça fait mal. En somme, psychiatres et psychologues sont profondément atteints par l’affaire du statut des psychothérapeutes : c’est le périmètre de leur pratiques légitimes qui tremble sous le coup de la demande sociale. Et si les psychologues en profitent pour s’aventurer, au moyen même de cette pression sociale, sur la chasse gardée des psychiatres, ces derniers se barricadent derrière un positivisme de bon aloi — ce qui pourrait, si l’on n’y prend garde, rallumer les feux de l’anti-psychiatrie la plus bête. Or, le commun dénominateur de ces deux mouvements est simple : c’est l’incapacité à mettre en perspective critique le mythe de la « demande des usagers », tenue pour un fait brut.
Ces trois obstacles à l’élaboration des bonnes questions semblent donc déboucher sur des questions de sociologie : que sait-on, au juste, du public qu’on s’empresse de protéger, qu’on aplatit sur le seul rôle des « usagers », et plus généralement, de la fonction sociale des soins psychiques (informels ou véritablement thérapeutiques) dans le champ actuel de la santé mentale ? Que sait-on, ensuite, des « psys », tels qu’on les amalgame (universitaires et non-universitaires, employant des techniques reconnues ou pas, et sans que ces deux dimensions coïncident toujours) ? Va-t-on aujourd’hui remplacer l’enquête empirique sur qui, quoi et comment, par un « principe de précaution » appliqué lui-même sans précautions ?
Or que sait-on donc, sociologiquement, de ces problèmes ? La réponse est claire : rien.
Je n’ai aucune volonté provocatrice : que le lecteur essaie d’évoquer une référence docsgraphique majeure sur l’évolution des traitements psychothérapiques considérée comme problème social et politique, depuis les années 80, une étude épidémiologique de l’INSERM, le moindre rapport du Ministère de la santé ; en sociologie, quelques chapitres dispersés[25] ; en économie de la santé, le néant. Le sondage BVA dont j’ai parlé plus haut n’est significatif de rien, ai-je dit : je me reprends, il est significatif, accompagné de ses commentaires biaisés, du vide qu’il sert à couvrir. Il semble qu’après la magistrale Gestion des risques de Robert Castel, en 1981, il y a 25 ans, la recherche sur le domaine se soit entièrement tarie[26] .
Voilà pourquoi ce livre offre une base commode : en mesurant les décalages entre ce qu’il prédisait et ce qu’on peut observer aujourd’hui, le phénomène actuel pourra peut-être donner lieu à des hypothèses moins soumises aux passions que celles qu’on nous assène en ce moment comme des évidences — qui imposeraient, en plus, des plans d’urgence.
Robert Castel énumérait trois axes qui paraissaient, en 1981, commander l’évolution à venir de la santé mentale, autour des psychothérapies envisagées comme des faits sociaux, scientifiques et politiques :
« [1.] un retour en force de l’objectivisme médical qui replace la psychiatrie dans le sein de la médecine générale ;
[2.] une mutation des technologies préventives qui subordonne l’activité soignante à une gestion administrative des populations à risques ;
[3.] la promotion d’un travail psychologique sur soi-même qui fait de la mobilisation du sujet la nouvelle panacée pour affronter les problèmes de la vie en société »[27] .
Je propose de reprendre ces entêtes avec l’hypothèse que l’amendement Accoyer, dont il est vain de croire qu’il tombe du ciel, marque dans un processus ancien une césure définitive.
1. Le retour dans le giron de la médecine générale est aujourd’hui devenu un mot d’ordre de la psychiatrie universitaire dont l’intelligence exacte est cruciale. Il a de multiples significations, mais on peut exploiter ses incidences sur les psychothérapies pour apprécier la force des courants qui portent l’appel à la réguler. Car ce mot d’ordre consomme la captation du discours légitime en psychiatrie par les enseignants des facultés, au détriment des psychiatres du cadre, ce que parachève depuis peu la confiscation totale des internes par les hôpitaux universitaires. Or, l’élite académique étant sélectionnée par le biais tyrannique de la publication dans des revues à impact-factor élevé, leur excellence se mesure à la virtuosité dans le maniement de la psychométrie, et moins au talent clinique qu’aux compétences neurobiologiques[28] . Ce qui a changé, toutefois, c’est l’émergence de neurosciences psychiatriques enfin intéressantes ; elle a dédouané la psychiatrie universitaire de la tare de conservatisme réactionnaire dont parlait encore Robert Castel, et qui, dans les années 70, avait déclenché l’insurrection des hospitaliers du cadre, plus engagés socialement. Il y a de meilleures raisons, en 2003, de faire confiance au progrès scientifique en psychiatrie. Or la TCC, type de la thérapie objective, quantifiable (donc publiable par les journaux médicaux indexés), viendrait aussi, croit-on, à la rencontre des besoins des hôpitaux qui gèrent le gros des malades. Car si ces derniers déshospitalisent sous la contrainte budgétaire, l’externalisation des patients crée des besoins de suivi considérables, et implique de faire d’emblée barrage à l’occupation des lits qui subsistent par de petits névrosés de ville. Entièrement conjugable avec les psychotropes, la TCC apparaît dès lors comme la panacée[29] . Le principe d’évaluation permanente qui la régit comble les technocrates, d’autant que sous sa forme standardisée, la TCC accepte de réadapter un patient en fonction de son idée de la normalité (on y liquide un symptôme « local ») sans interroger la demande de soin elle-même, ni la personnalité. Du coût, le ratio coût/bénéfice se chiffre. Quant aux soupçons éthiques qui grevaient les thérapies comportementales des années 70, ils sont balayés : l’éthique est devenue un paramètre, mis en balance avec l’utilité sociale ou privée — voire quelque chose dont on pourra poser la question, mais une fois le symptôme traité… C’est l’abstention médicale traditionnelle à l’égard des usages de la santé recouvrée. Mieux, comme ces thérapies sont aussi cognitives, elles échappent au reproche de n’impliquer aucun « travail sur soi » : le soi existe, dans la TCC — avec ce paradoxe, dont la réalité est désormais statistique, de passerelles multiples entre TCC et psychothérapies dynamiques, des patients décidant de poursuivre en psychanalyse l’exploration de ce soi, ou à l’inverse, contents de leur psychanalyse, venant en TCC pour liquider un résidu de symptômes[30] . Enfin les TCC ne sont pas uniquement réductibles à des stratégies d'adaptation aveugles aux demandes de l'entourage (et par extension à des représentations idéologiques de la normalité sociale); un de leurs intérêts largement méconnus par leurs critiques sociologues ou psychanalystes, mais pas du corps médical, est leur usage dans l'adaptation mentale de certains patients à la maladie somatique grave: affection cardio-vasculaire (l'angine de poitrine avec son cortège anxieux), ou certains handicaps (après des opérations mutilantes), etc. Cependant, l’appropriation par les universitaires du discours scientifique légitime coïncide, en face, chez les psychiatres du cadre, avec une crise intellectuelle intense. Littéralement esclaves de dispositifs sociaux qui faisait la raison d’être du secteur à la française, mais qui, avec la pénurie, dévorent désormais leurs forces vives, les services ne transmettent plus de savoir clinique autonome. Quant à la psychothérapie « institutionnelle », ce pilier de l’ethos psychiatrique depuis Esquirol, le désert croît. Car qu’est-ce qu’une institution peu à peu dépouillée de son personnel ? On assiste alors, par un renversement inouï, au retour de certains psychanalystes à l’hôpital, mais non plus, comme dans les années 70, pour contester le modèle asilaire de la maladie mentale : pour y refaire des présentations de malades (!) et maintenir la mémoire de la clinique des « classiques » (c’est frappant chez les lacaniens, qui ont republié quantité de travaux historiques).
Ailleurs, les thérapies familiales font l’objet d’investissements passionnés. Mais partout, sans doute pour préserver a minima la dignité intellectuelle de l’activité soignante, les psychiatres s’agitent. On peut alors redouter deux choses. La première, ce sont les effets ponctuels de la disparition de la prise en charge totale, sinon totalitaire, qui était autrefois la norme pour les malades mentaux. Au mieux « vus », mais sûrement plus « suivis », ces derniers recherchent hors-hôpital qui les accompagnera. Il faudrait d’ailleurs vérifier avec soin l’impression banale des psychanalystes non-médecins qui voient sonner à leur porte des psychotiques las des files d’attente du service public et de la superficialité des entretiens qu’on est malheureusement réduit à leur accorder [31] . La seconde, plus générale, est que la dialectique de l’individu moderne ne se réduit pas au mythe des « usagers de la santé mentale ». Rien ne prouve que l’intention louable de satisfaire le client dans des structures contrôlées n’engendre pas mécaniquement, à la marge, un refus armé de laisser médicaliser tous les troubles. Les passerelles entre TCC et autres thérapies, l’éclectisme, en somme, des démarches, sont à ces égards significatifs. L’usager-citoyen pourrait aussi préférer la non-intervention de l’Etat pour des raisons de fond[32] .
De toutes façons, les droits concédés à l’usager-citoyen de la santé mentale ne le sont que dans un cadre médico-administratif qui vise surtout à se protéger de lui et de ses plaintes. Les thérapies alternatives non-conventionnelles ont alors de beaux jours devant elles, surtout si la prescription de psychotropes par les généralistes continue à servir de base indiscutée du traitment et l’indication de psychothérapie de supplément luxueux. On pourrait même voir, je le redis, se rallumer devant ce déni institutionnel d'attention à la « personne globale », l’incendie de l’anti-rationalisme anti-psychiatrique le plus néfaste.
2. Touchant la seconde thèse de Robert Castel, il est clair en ce moment que tout le projet « disciplinaire » de la santé mentale, si redouté des intellectuels de gauche des années 80, s’est entièrement effondré[33] . La gestion des populations à risques n’a plus besoin de caution psychiatrique forte. Le traitement social de la misère suffit. Franchement, pour le fonctionnaire de mairie distribuant de maigres secours, quelle différence pratique entre un psychotique, un peu délirant et agressif, et un chômeur en colère, analphabète et alcoolisé ?
L’aiguillage diagnostic et l’expertise psychotechnique, s’ils n’ont pas disparu, semblent aujourd’hui les dernières pudeurs d’un âge d’abondance médico-sociale révolu. Robert Castel identifiait à l’époque une double tendance : d’une part, une volonté de psychiatriser-psychologiser la condition de populations à risques, et d’autre part, la promotion individuelle d’un « potentiel psychologique » à intensifier. Mais un second double mouvement, superposé à et non complémentaire au premier, naît sous nos yeux, qui importe suprêmement aux psychothérapies. C’est ce second mouvement dont je me demande s’il n’est pas la grande leçon à tirer des événements actuels : en somme, l’amendement Accoyer formalise l’émergence d’une notion élargie de santé mentale (plus seulement psychiatrique ni psychologique, mais tendant à légiférer sur le « bien-être » en général) entendue comme un enjeu collectif, voire un projet de société, et il inscrit dans ce cadre nouveau le projet d’une prise en charge ciblée d’individus à risques, que la loi doit protéger en tant qu’individus (autrement dit, non plus, ou plus seulement parce qu’ils appartiennent individuellement à une population à risques, mais parce qu’en tant qu’individus ils ont des droits sociaux à la santé mentale). Ce sont là des processus de fond, et on voit pourquoi l’amendement Accoyer traduit une anxiété compréhensible devant la zone floue qui voit les mêmes anciens agents informels du « potentiel psychologique » à intensifier, lesquels ne dérangeaient pas grand-monde et faisaient plutôt sourire, lentement s’approprier des plaintes plus graves, plus médicalisables, sans qu’on ait vu où la ligne jaune était franchie. Certes, cet amendement pourrait évoluer dans sa forme ; mais les problèmes auxquels il tentait de faire face, même sans le savoir, restent. Qu’on médite ainsi sur l’explosion de la victimologie, sur le recours confusionnel à l’idée de traumatisme, sur l’exigence de « cellules psychologiques d’urgence », non seulement suite aux catastrophes, mais, on l’a vu, à l’annonce d’un licenciement collectif[34] . Car, pour aller vite, dès le moment où le fait que la plainte du traumatisé ne soit pas « entendue » (i.e. entendue comme il faut qu’elle le soit de son point de vue à lui) est considéré comme un redoublement de son traumatisme, tout le surplomb objectivant du praticien traditionnel de la santé mentale sur son « cas » paraît barbare. Or la prolifération des traumatisés est un fait social (que de nouveaux harcèlements, sexuel, moral, etc., construits comme des pathologies mentales !). A cet appel à être entendu, fait pendant une offre « d’écoute » tous azimuts. Or, loin de préserver, comme le suppose Jacques-Alain Miller[35] , un îlot de subjectivité dans le monde cruel de la technomédecine, elle risque de prendre à revers tous ceux qui n’ont que leurs titres de science à opposer à l’empathie un peu poisseuse des écoutants humanistes ; voire de servir à désigner les esprits critiques, et je pèse mes mots, à la vindicte populaire. Il y a là, en tout cas, une inépuisable ressource pour des psychothérapies alternatives qui se serviront, à n’en pas douter, de l’anti-scientisme comme d’un étendard. Nulle loi, sauf à être longuement pesée, ne fera obstacle à cette radicalisation, si elle ne l’accélère pas.
Or c’est là, je crois, un réseau de faits sociaux infiniment plus prégnants que le mythe bureaucratique de l’usager de la santé mentale. Il devrait susciter des pouvoirs publics plus d’attention qu’aux rumeurs et aux scandales ad hoc. Car « l’individu à risques » (la victimologie en offre un exemple parmi d’autres) mérite un examen dont les modalités sont presque toutes à inventer. Toute loi sur les psychothérapies aurait besoin de s’en informer, plutôt de ne voir que ce que la bureaucratie sait gérer par ailleurs : des « usagers » gentiment organisés en associations-partenaires, occasion, enfin, de se défausser de responsabilités publiques en les privatisant par consensus[36] .
3. C’est alors l’évolution de la culture psychologique de masse qui doit nous intéresser[37]. Comment, tout d’abord, est-on passé de pratiques plutôt libertaires, voire opposées à la société de consommation, qui visait l’épanouissement du soi (la « self-activation » d’Abraham Maslow) et la réconciliation avec le corps, à ce colossal marché de la performance individuelle qui s’est approprié, à l’inverse, l’idéal d’une surnormalité heureuse, et a ainsi psychologisé « l’idéologie de la réussite » ? (Claude Boiocchi)[38] Comment, ensuite, le « développement personnel » (DP), qui se transforme depuis les années 80 sur cet axe, a-t-il pu se présenter comme base pour des thérapies, au point d’inquiéter les pouvoirs publics ? Voilà qui force des aveux gênants.
Car il faut savoir que 10% des livres vendus dans le monde sont du DP. Un monument de la littérature New Age comme La prophétie des Andes, de James Redfield, a atteint 100 millions d’exemplaires. La cassette-vidéo d’Anthony Robbins, Personal Power, a trouvé 25 millions d’acheteurs à 69,95$ pièce. La puissance de la pensée positive de Norman Peale, traduit en des dizaines de langues, s’est vendu à 15 millions d’exemplaires. Et ce n’est nullement un phénomène occidental : avec l’ouverture de la Chine sur le monde, le DP a pénétré une culture qu’on n’aurait pas imaginé si réceptive (de 1986 à 1989, pendant ce qu’on a appelé la « Maslow craze », il s’est écoulé presque 600000 exemplaires de ses ouvrages de psychologie humaniste). Des groupes de presse internationaux, comme l’ancien Vivendi Universal Publishing, ont manœuvré pour s’assurer le contrôle de collections si rentables (comme les Presses de la Renaissance). A la différence de ce qu’observait Robert Castel, le phénomène n’est plus marginal. Les classes moyennes et supérieures dévorent du DP ; ses stratégies ont été intégrées par de grandes entreprises, pour sélectionner à l’entrée puis pour ventiler leurs cadres et entretenir la « capacité au changement ». Pour marquer fortement les choses, l’irrationalisme dans la « direction des ressources humaines » présente peut-être un danger beaucoup plus grand pour la santé publique que les manipulations imputées aux sectes ou aux psychothérapeutes informels ; le mettre en évidence serait toutefois moins consensuel. Or cela, tout le monde en parle dans les milieux médico-psychologiques, mais personne ne sait l’analyser. Il faudrait donc s’immerger dans cette littérature, et chercher comment s’est opérée la dérive qui, de l’apologie d’une surnormalité épanouie, a conduit à remédier aux déficits ponctuels de tel ou tel dans sa vie professionnelle ou sentimentale, pour évoluer peut-être vers des pratiques prenant l’ensemble de la vie en charge, troubles psychiques compris, et qui concurrenceraient peut-être les psychothérapies sérieuses sans avoir jamais l’air d’être autre chose que des « thérapies pour normaux ». Les modalités de cette évolution, et surtout, si elle est si claire et si dangereuse que cela, sont aujourd’hui inconnues. Et il est quand même curieux de légiférer sur des techniques dont on ignore tant : nombre de clients, distribution par catégories socio-professionnelles, répartition géographique, sommes en cause, cadres juridiques, nature des pratiques suspectes, effets thérapeutiques, idées qu’elles se font de leur identité et de leur légitimité, origine historique, parcours-types, etc[39] . Il a suffi qu’on découvre que n’importe qui pouvait se dire « psychothérapeute » pour qu’un fait de société aussi dense devienne la cible de velléités d’encadrement légal, justifiées a posteriori par des scandales dont nul ne sait s’ils sont exemplaires ! On se gardera donc d’accroître la confusion, en pointant cependant plusieurs éléments aisés à vérifier. Le premier, crucial pour comprendre le jeu des « psychothérapeutes non-académiques », c’est que ce jeu est un double jeu. Carl Rogers, mort en 1987, inventeur de la client-centered psychotherapy, l’a bien formulé[40] . Le patient, dit-il, ne doit pas être un patient, mais un client. Double jeu, double gain : cela fait du bien aux gens de se voir autrement que comme des malades, même s’ils sont venus exposer de graves difficultés mentales, et protège aussi le thérapeute, qui engrange le bénéfice d’une demande de soins implicite et déculpabilisée, mais sans pratiquer illégalement la médecine. Ainsi, il n’y a plus que deux personnes face-à-face dont, à la limite, il est presque « indifférent de dire que l’un est le thérapeute et l’autre le patient » (Claude Boiocchi). Une autre astuce est la promesse implicite de guérison dans l’adoption d’un style de vie psychologiquement régulé, en groupe, ou seul. Son moyen typique est le commentaire extatique du client dans les préfaces ou sur les quatrièmes de couverture des livres de DP : là, le client assume seul la réalité vécue de son mieux-être, sans que son maître à penser ait fait autre chose que donner l’exemple. Or il s’agit souvent de dépressions, de phobies, d’épisodes névrotiques sévères — au point qu’on enrage qu’il n’existe aucun délit de guérison illégale… Ce dispositif, il faut enfin l’avouer, restera insaisissable. Social (sinon enraciné dans des structures psychiques profondes), il fuira par les mailles du filet, si serrées soient-elles. Exquise impudence, un site en ligne de psychothérapeutes informels proposait d’ailleurs l’ultime parade à l’amendement Accoyer : se dire non plus bio-énergéticien, sophia-analyste, mais « psychothérapeute européen » — ou bien psychanalyste, puisque leur statut serait mis à part…[41]
C’est donc sur la psychanalyse que j’entends conclure.
Il est vraisemblable que l’amendement Accoyer frappait paradoxalement à peu près la seule psychothérapie pratiquée par des non-médecins et des non-psychologues sur laquelle on puisse avoir des garanties, tout en n’empêchant pas que les pratiques douteuses se perpétuent. (Mutatis mutandis, on risque une législation aussi fragile que les lois anti-sectes, qui mordent sur les libertés publiques et s’exposent à l’arbitraire des tribunaux.) La première menace sur la psychanalyse est le tarissement de son recrutement hors du milieu médico-psychologique. Mais c’est une forte caution, je pense, que des linguistes, des juristes, des sociologues, des philosophes, des biologistes ou des mathématiciens, se destinent à cette discipline, et se plient aux formations dispensées dans des institutions qui existent depuis des dizaines d’années, et dont les travaux sont célèbres. C’est même le champ entier de la santé mentale qui s’est ouvert en grand aux sciences sociales ces dernières années, précisément pour se mettre au diapason de son objet. Il faudrait alors estimer combien, ni psychiatres ni psyc
Pierre-Henri Castel est psychanalyste, membre de l'ALI (Association Lacanienne Internationale), chargé de recherches au CNRS (Philosophie des sciences, IHPST-Université de Paris 1) et chercheur associé au CESAMES (Centre de Recherche Psychotropes, Santé mentale et Société, CNRS-Université de Paris 5)
« Art. L3231 : Les psychothérapies constituent des outils thérapeutiques utilisés dans le traitement des troubles mentaux.
Les différentes catégories de psychothérapies sont fixées par décret du ministre chargé de la santé. Leur mise en œuvre ne peut relever que de médecins psychiatres ou de médecins et psychologues ayant les qualifications professionnelles requises fixées par ce même décret. L'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé [apporte son concours à l'élaboration de ces conditions.
Les professionnels actuellement en activité et non titulaires de ces qualifications, qui mettent en œuvre des psychothérapies depuis plus de cinq ans à la date de promulgation de la présente loi, pourront poursuivre cette activité thérapeutique sous réserve de satisfaire dans les trois années suivant la promulgation de la présente loi à une évaluation de leurs connaissances et pratiques par un jury. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »
Cet amendement au Code de la santé publique, proposé par Bernard Accoyer, député UMP de Haute-Savoie, lui-même médecin, a plongé dans l’ébullition un milieu qui ignorait jusqu’alors qu’il formait aux yeux des pouvoirs publics une cible administrative comme une autre[1] . Une définition légale de la psychothérapie coupe désormais court à la discussion scientifique au nom de la protection d’un public dit « fragile », les psychanalystes détenteurs d’un savoir sophistiqué, culturellement et socialement classant, se retrouvent amalgamés à des « psys » dépourvus de toute caution intellectuelle et historique. Des praticiens chevronnés devraient justifier leur compétence devant des jurys dont personne ne sait de quoi ils seront faits. Pour leur part, les psychothérapeutes informels s’épouvantent de la médicalisation forcée de leur pratique. Ils sont rejoints en cela, quoique pour des motifs incompatibles, par la plupart des psychanalystes ni médecins ni psychologues, mais aussi bien psychiatres, et même universitaires, investis de longue date dans les soins mentaux, et qui tiennent à disjoindre la dynamique de la cure de tout bénéfice thérapeutique (soutenant en bonne orthodoxie que cette disjonction est au principe de l’efficacité durable de leur action). En tiers, enfin, les tenants des thérapies cognitivo-comportementales (TCC), déjà médicalisées, et calculées précisément pour répondre aux critères psychométriques qui satisfont aux impératifs de gestion de la santé (mentale ou pas), se réjouissaient, pour citer un forum sur Internet, qu’on « fasse enfin sortir le loup du bois ».
A l’arrière-plan, enfin, se profilent aussi d’autres enjeux. Les psychothérapies seront-elles remboursées ? Sur quelles bases ? Y aura-t-il protection du titre ? Ou un délit d’exercice illégal de la psychothérapie ? Pourra-t-on poursuivre un thérapeute pour faute ? Quelle part sera dévolue à l’université dans leur formation ? Quelle autre (si on leur en concède une !) aux instituts privés ? Sur quels critères les homologuer ? Question enfin extrêmement grave et qui ne paraît pas avoir reçu l’attention méritée, comment leur fonctionnement sera-t-il altéré, avec quels effets, non seulement sur la liberté de pensée de leurs membres, désormais dépendants comme jamais de leurs instances, mais même sur l’authenticité de leur démarche ?
Les adversaires de l’amendement, emmenés de moins en moins par les représentants d’associations de psychothérapeutes informels et de plus en plus par Jacques-Alain Miller, ont donc éprouvé un vif soulagement devant le recul de Bernard Accoyer, lequel affirme aujourd’hui, face au tollé, ne plus vouloir encadrer que ce qu’il appelle « psychothérapies lourdes », laisser ceux qu’elles ne concernent pas (censés non-malades ?) « voir qui leur chante » et surtout, exclure la psychanalyse du champ de cette réglementation[2] .
Soulagement à mon avis trompeur, et je dirai pourquoi.
Mais il reste à mieux saisir la nature de la réponse apportée par le milieu « psy » à ces défis, qui a été, et qui reste à ce jour, je le dis sans intention péjorative, corporatiste (car il y va de la survie de milliers d’acteurs), puis à proposer une lecture distanciée de ce phénomène, disons, à partir des années 80 — lecture qui, je l’espère, permettrait de suggérer quelques coups justes à jouer dans une partie compliquée, et qui n’est nullement achevée. Or ces coups justes, vais-je soutenir, sont plus des questions empiriques à poser (auxquelles il faudrait se donner les moyens de répondre) et bien moins des solutions à des difficultés dont on fait état comme d’évidences (la protection du public fragile en est une), mais dont une bonne partie sont parfaitement imaginaires, ou bien entièrement conjecturales.
« Les » psychothérapies, de la façon la plus englobante possible, englobent l’ensemble des réponses données par des professionnels ou des semi-professionnels à des demandes de soins psychologiques (ou du moins, vécus ou auto-catégorisés comme « psychologiques »). Elles vont du « travail sur soi » utilitaire (à la limite de la simple prise de conscience dans la recherche de performances au travail, dans le couple) à la gestion de malaises infra-cliniques que les clients ne tiennent pas à médicaliser, les psychothérapies ayant alors des accointances avec les « médecines douces [3] . Puis, et l’on franchi là un seuil crucial, elles s’adressent aux états « névrotiques », qui sont spécifiquement pris en charge par les « psychothérapies psychanalytiques », ou bien alors aux symptômes pris un à un comme cibles, sans exploration personnelle fouillée (objets privilégiés des thérapies cognitivo-comportementales : TCC). On passe de là aux prises en charge au long cours de pathologies chroniques, exigeant un soutien constant et une surveillance avertie (de l’alcoolisme à la schizophrénie), que de moins en moins de psychiatres ont les moyens matériels d’assumer en libéral ou dans le public, mais qui relèvent de leurs attributions Et l’on arrive enfin à la psychanalyse stricto sensu, occupant le pôle opposé mais symétrique du plus bas degré de la psychothérapie, puisqu’elle propose moins un travail sur soi, qu’une élucidation (partielle) du labeur que l’autre (mon semblable, mon déplaisant « prochain », mon partenaire sexuel, voire mon monde social et sa langue) impose à chacun. Mais cette élucidation est indirectement thérapeutique (guérir est l’effet, non le but). Offrant à l’individu moderne une de ses dernières grandes aventures intérieures, elle est enfin valorisée par la haute culture comme un lieu d’exception.
Si l’on ne veut pas sombrer dans le débat préalable de savoir si la psychanalyse est ou pas une psychothérapie, ou si les psychothérapies doivent ou non être médicalisées, il suffit, j’insiste, de partir du fait de la demande de soins psychologiques : de quelque façon subtile ou prudente que le destinataire de cette demande se représente ce qu’il fait, c’est à ce titre, et à ce titre seul, qu’il sera traité en psychothérapeute — et, ajouterai-je, que cela lui plaise ou non. En un mot, peu importe désormais que le mot « soin » figure dans une demande comme : « Soignez la maladie dont je souffre ! », ou dans cette autre, désormais essentiellement analogue dans nos sociétés : « Prenez soin de moi ! ». Le temps n’est plus ou le caractère très articulé et hiérarchisé conceptuellement de l’offre de soin permettait encore de dire, pour citer Lacan, qu’une psychanalyse, c’est ce qu’on demande à un psychanalyste : on travaille (surtout quand on est débutant) à la rigueur en psychanalyste avec la souffrance psychique, mais les patients découvrent souvent au fur et à mesure la technique propre à ceux qu’ils consultent, et de toutes façons, la prodigieuse extension de la culture psychologique à tellement abrasé les différences entre les méthodes, aux yeux du public comme des acteurs de la santé mentale, que fort nombreux sont les éclectiques, qui conjuguent psychothérapie psychanalytique, TCC, hypnose, et parfois avec le même patient.
Conformément aux prédictions de Robert Castel[4] , la norme ultime de tout traitement psychothérapeutique, qui a été dans les faits la psychanalyse jusqu’aux années 80, est donc devenue la triste victime de son succès. A mesure que s’incorporaient aux discours quotidiens les idéaux « relationnels », une certaine attention à l’enfance comme l’âge à scruter où toute la vie future se déciderait, dans la mesure aussi où la sexualité épanouie est revendiquée comme un lointain héritage freudien, ou que la lecture « oedipienne » des liens familiaux envahit les médias, tandis enfin que des mots comme « refoulement » n’ont plus besoin de légitimation théorique, plus rien ne permet de parer à la vulgarisation-dépréciation de la psychanalyse. Sa capacité à en imposer, point décisif que masque en ce moment un pur succès de lobbying, par l’autorité liée à sa difficulté intrinsèque, s’est définitivement émoussée. Les thérapeutes non-psychanalystes savent en effet que ce qu’ils offrent n’arrive pas à la cheville des productions freudiennes ; cela ne les intimide plus, et ils en font même un argument pour s’approprier des formes de malaises psychologiques plus diffus qui ne justifieraient pas d’une démarche aussi longue et coûteuse qu’une cure[5] . C’est ce double effet (1. caractérisation de la psychothérapie par le fait social massif d’une demande indistincte de soins psychologiques, et 2. ruine du paradigme de la psychanalyse comme norme des autres thérapies de type relationnel) qui a abouti à la situation présente.
Tout cela rend presque illisible le chiffre considérable des personnes ayant suivi en France une psychothérapie, comme le jugement globalement favorable qu’elles expriment. Il y aurait eu ainsi environ 800000 personnes de plus de 15 ans en psychothérapie en 2001, soit 1,7% de la population, sans compter les enfants qui sont de gros consommateurs (on ajoute alors, Dieu sait pourquoi, 200000 au premier chiffre), et, en incluant cette fois ceux qui ont dans le passé eu recours à ce type de soins, 5,2% de la population générale, soit 3 millions d’individus concernés (avec les enfants, qu’on ajoute selon les mêmes obscurs critères). Ces chiffres ont été obtenus par sondage sur 8069 adultes ventilés selon la méthode des quotas par l’institut BVA, d’une part, et, d’autre part, réexaminés à la lumière d’une enquête en ligne du magazine Psychologie [6] , dont la méthodologie ressemblait fort à la méthode controversée de l’enquête américaine du Consumer Report de 1995, laquelle avait donné lieu à des études statistiques fouillées, mais peu concluante[7] . Curieusement, le taux de satisfaction dans les deux enquêtes françaises est identique (84%)…
Mais que valent ces impressionnantes données numériques ?
Pas grand-chose. Car, comme ce sondage a été suffisamment bien conçu pour estimer le niveau d’information des répondeurs, on y découvre que plus de 40% ignore la méthode qui leur a été appliquée — quand ils n’appellent pas psychothérapie les 15 minutes bimensuelles chez le médecin qui renouvelle leur ordonnance de psychotropes. De plus, la confusion entre psychothérapeute, psychiatre, psychologue ou psychanalyste y est courante. A supposer, ensuite, qu’il y ait entre 12 et 30% de personnes « en analyse » (selon l’inclusion ou pas des « psychothérapies d’inspiration psychanalytique » dans l’échantillon), presque 60% des « analysés » (car la plupart semblent considérer avoir fait une psychanalyse, aurait-elle duré six mois) sont incapables d’identifier l’école dont relève leur psychanalyste. Plus cocasse, est fréquemment considérée « thérapie de couple » une thérapie où l’on parle de son conjoint, pas celle où l’on se rend en sa compagnie. On pourrait se consoler avec le public mieux informé de Psychologie, notre seconde source. Mais si les titres des psychothérapies y sont mieux repérés, surtout s’il s’agit des psychothérapies humanistes (rogériennes, psycho-corporelles, etc.), les bizarreries n’y sont pas moindres. Ainsi, dans ce second échantillon (nullement représentatif, lui, comme l’échantillon sondé par BVA), 40 % des patients seraient censément « en analyse », ce qui se ventilerait : 20% d’analyse freudienne, 7% de lacanienne, 4% de jungienne et 0,5 % de kleinienne, le reste, soit 9,5%, étant défini par les intéressés comme de la « psychothérapie analytique ». Je passe sur la qualité des antennes nécessaires à la détection des qualités lacaniennes ou freudiennes du silence (au moelleux du divan ?), pour m’étonner de la place minime des psychothérapies psychanalytiques. Comment peuvent-elles ne compter que pour 25% des analyses ? Leur rythme plus lent (en France 2 à 3 séances par semaine), et la disposition en face-à-face les rendent, de l’avis général, plus courantes que la cure standard[8] . Si la psychanalyse, dans ce public présumé mieux informé, est soumise à de pareilles distorsions d’image, aussi improbables au vu des inquiétudes actuelles des praticiens, on se demande par contrecoup ce qui a été saisi dans les autres cas. Quand à ce que déclarent les psychiatres libéraux, sur lesquels on dispose d’une enquête de 1994 du Syndicat des Psychiatres Français, et qui tous ou presque se déclarent psychothérapeutes, si 60% se réfèrent à la psychanalyse et le reste à « rien de spécifique », la moitié déclarait pratiquer la psychanalyse (à raison de séances d’une demi-heure au moins), un sixième les TCC, ou l’hypnose, ou les thérapies familiales (exemple du syncrétisme actuel) et un sixième encore la relaxation[9] .
Tout n’est pas ici nécessairement erroné. Si chaque psychothérapeute reçoit environ 60 patients par an, toutes techniques confondues, ce qui paraît raisonnable, on retrouve par une règle de trois à peu près les 10 à 15000 praticiens censés exercer en France[10] . Mais en divisant quelque chose par quelque chose, on finit toujours par retrouver quelque chose. Autant dire que le besoin d’accorder entre eux ces chiffres est criant, et qu’un sondage ou une enquête en ligne sont loin du degré de précision requis pour éclairer des décisions de l’importance de l’amendement Accoyer.
En fait, la mise en scène de ces chiffres donne leur véritable sens. Dans un exposé aux Etats-Généraux de la Psychothérapie en mai 2001, Serge Ginger, Gestalt-thérapeute militant pour un statut des psychothérapeutes (aujourd’hui catastrophé du tour restrictif que lui donnait l’amendement Accoyer), les ponctue de détails plutôt malaisés à relever dans la pluie des statistiques, mais qui touchent juste : après une psychothérapie, dit-il, la consommation de psychotropes baisserait considérablement (d’un tiers pendant la thérapie, pour chuter à 5% après, selon les répondeurs en ligne de Psychologie). Il est certain qu’il s’agit d’un poste de dépense élevé pour la sécurité sociale ; l’intention est donc transparente. Mais il n’est pas sûr que les consommateurs de psychotropes distinguent clairement anti-dépresseurs, hypnotiques, benzodiazépines, neuroleptiques et régulateurs de l’humeur, et peut-être même toutes ces substances d’autres, qui ne sont pas des psychotropes du tout. D’autre part, comme il est crucial de monter en épingle la relation des Français aux psychothérapeutes (qui est quatre fois moindre qu’aux États-Unis, où, il est vrai, le conseil spirituel occupe une grande place), il ajoute : « Lorsqu’on admet que l’impact d’une psychothérapie touche directement les proches (conjoint, parents, enfants), on voit de suite qu’en réalité, la psychothérapie concerne, plus ou moins directement, près de huit millions de Français »[11] . Ce style de commentaire pseudo-sociologique n’est nullement exceptionnel, et s’il n’est peut-être pas faux, il est aussi important de souligner qu’il n’existe aucun moyen, aujourd’hui, de savoir en quoi.
On ne peut en tout cas tirer de ces indications, et je veux commencer par insister sur ce point, rien qui alimente aucune position, quelle qu’elle soit, tellement elles sont ployables à toutes les rhétoriques, et peuvent alimenter toutes les peurs absurdes comme toutes les méconnaissances dangereuses. C’est là un vaste chantier qui s’ouvre, dont on ne peut prédire quels résultats il va produire, mais dont l’urgence est patente.
*
La vraie difficulté est donc qualitative. On ne peut lancer une étude sans savoir quelles questions poser à quel objet, dans quel but, dans quel contexte, avec quels moyens statistiques, et pour vérifier quelles hypothèses. Or sur la voie des bonnes définitions comme des bonnes questions, on rencontre toute une série d’obstacles.
Certains sont connus.
On dénombrerait, dit-on, au moins 400 formes de psychothérapies. De fait, détecter l’intrus dans la liste suivante deviendra peut-être un jour un grand jeu de société : bio-énergie, psychosynthèse, Gestalt-thérapie, sophrologie, programmation neuro-linguistique (confondue par erreur avec le conditionnement neuro-associatif), analyse transactionnelle, bio-analyse, somatothérapie, psychothérapie corporelle intégrée, étiopsychologie, relaxologie, co-conseil, cri primal, rebirth ou bio-respiration, thérapie client-centered, rolfing, andragogie, kinésiologie, sophia-analyse, stratégie de vie, sans oublier healers, praticiens de la relation d’aide, graphométriciens, agents d’intervention de crise et médiateurs ethnocliniciens [12] . Non seulement plusieurs d’entre elles sont interchangeables, mais leur efficacité spécifique dépend explicitement de facteurs comme la personnalité du praticien et du groupe qu’il structure autour de lui. Ces groupes, pour ce qu’on a pu apprécier aux Etats-Unis (les études plus récentes et plus françaises manquent cruellement), se font et se défont avec rapidité. Tous prônent un éclectisme consolidé par la récusation des sociabilités conventionnelles et de tout intellectualisme[13] . Mais les versions les plus récentes ne manquent pas de cautions de respectabilité : une société savante internationale, un journal (avec comité de lecture, peer-reviewing, etc.), des programmes de formation longs et standardisés. De telles « références » servent, je suppose, à intimider les bureaucrates, mais leur contenu scientifique n’engage, pour le moment, que leus lecteurs. (Je mets à part, pour y revenir, les pratiques dont l’effet psychothérapeutique est officiellement marginal, comme les spiritualités inspirées de l’Orient, ou la dégénérescence de la vieille psychologie industrielle autoritaire, au service des patrons rationnels des années 50, en « développement personnel » autogéré.)
Mais d’autres obstacles à une réflexion sérieuse sont moins apparents.
J’en vois en fait quatre :
1. l’« imaginaire professionnel », pour citer Robert Castel, des psychanalystes ;
2. les fantasmes des « usagers » (et sur les usagers), avec tout ce qu’un principe de précaution généralisé entraînerait de contre-productif ;
3. Les réticences de l’establishment médico-psychologique, qui pourrait être entraîné plus loin qu’il ne souhaite si l’on posait à fond la question des psychothérapies ;
4. Les carences de l’expertise sociologique depuis les années 80 — que je traiterai à part.
Les interventions de Jacques-Alain Miller dans la presse illustrent le premier point [14] ; elles témoignent avant tout de la certitude des psychanalystes d’avoir raison sur des questions où, jugent-ils, leur discipline, son histoire, voire son épistémologie, leur garantit la position de surplomb qui devrait en faire les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics. Il n’y a qu’un inconvénient. C’est qu’on peut avoir raison et se faire politiquement balayer. Comprendre ce fait tout simple suscite dans les discussions qui bruissent dans le milieu une réaction bien révélatrice : chacun rappelle avec force son attachement à ses principes de non-ingérence de l’Etat, ou son refus de la médecine mentale « objectiviste », comme si ce rappel, transcendant la crispation personnelle qu’il reflète (et il y a de quoi, assurément, se faire du souci, pour soi et pour ses patients !) allait miraculeusement réveiller une conscience collective endormie. Bien des psychanalystes comprennent aujourd’hui que si la psychanalyse a bénéficié d’une pareille immunité en France, ce n’était pas du fait de sa structure interne, ni de sa logique du sujet, ni du rapport quasiment hors-social qu’elle instituait par son abstention de principe à l’égard de ce qui est dit (sur le divan), ni par son prestige culturel repoussant avec tranquillité toute mise en cause, mais aussi, peut-être surtout, parce qu’elle profitait de niches juridiques, économiques, sociologiques, politiques, culturelles, dont la relative inertie a été confondue avec une promesse d’éternité. Seuls, semble-t-il, ceux qui ont été mêlés à l’évolution des hôpitaux psychiatriques, et qui ont mesuré la vanité des arguments cliniques quand il s’agit de « rationaliser les soins », ont senti le vent venir. La plénitude d’existence que procurait le statut de psychanalyste, livrant à la fois des clés fascinantes pour déchiffrer les agressions d’un monde extérieur qui nie souvent l’inconscient, avec les moyens financiers d’une passion unique, en résonance avec la haute culture, mais offrant aussi la sécurité non-négligeable de postures où des notables installés, aux commandes d’appareils considérables, peuvent se vivre eux-mêmes en même temps, fort sincèrement, comme des personnages subversifs, savants maudits par leurs pair, ou défenseurs héroïques de valeurs universelles mais « universellement refoulées » — voilà ce qui a obscurci la teneur des essais méritoires de sauver ce qui devait l’être. Car ces postures n’exercent plus l’effet puissant qui a été le leur jusqu’à la mort de Lacan ; elles continuent à captiver le petit peuple de la psychanalyse, et, par nostalgie, une frange vieillissante de l’intelligentsia. Mais ces propos acerbes, seraient-ils drôles et pertinents en leur fond, sont désormais prisonniers de la bulle « psy », et ne mordent plus sur le monde[15] . En somme, l’imaginaire professionnel des psychanalystes les menace de voir leurs efforts (efforts légitimes, qu’on m’entende bien), faute d’écho efficace, se réduire à des gesticulations corporatistes, souillées d’alliances circonstancielles et contre-nature, avec le risque accru de se révéler aux yeux de leurs vieux rivaux positivistes comme la caste faillie qu’on va enfin déboulonner de son socle. La psychanalyse a commencé ; elle pourrait aussi finir.
Les fantasmes des usagers, ou plus exactement les fantasmes qu’on construit à l’usage des usagers, dans une opération de captation intéressée de la fonction du porte-parole, sont un second obstacle à déblayer. On peut être franchement consterné du procédé. Que dire, par exemple, des glissements successifs par lesquels Françoise Sironi, dans un article récent[16] , en vient à supposer qu’il faut un statut des psychothérapeutes pour prévenir les abus sexuels sur les patients ? En quoi, grands dieux, un tel statut changerait-il quoi que ce soit ? Comme si leur niveau universitaire avait jamais empêché des sexologues, médecins éminents, couverts de titres, de se faire poursuivre devant les tribunaux pour viol, comme si le crime n’exploitait pas tous les moyens honorables, justice, secours aux enfants, que sais-je encore, précisément pour se perpétrer. Va-t-on pour autant interdire la médecine, les magistrats, les associations d’accueil aux enfants ? Malheureusement, il n’existe pas de lois contre les gens qui ne respectent pas les lois. Il y a des lois, c’est tout. La seule chose qui pourrait empêcher le non-respect de la loi, ce serait de la remplacer par des prescriptions obligatoires, contrôlées à tout instant ; c’est le totalitarisme, et il est évidemment incompatible avec les prémisses de Sironi. Celle-ci prétend alors que ces abus sont suffisamment fréquents pour justifier l’intervention urgente des pouvoirs publics. Sur quelles bases ? On ne sait même pas, je l’ai dit, combien il y a de psychothérapeutes en France, ni en quoi l’échantillon de « victimes de sectes » auquel elle joint celui des « victimes de psychothérapies » auto-proclamées (et l’on a vu quoi penser des capacités des gens à discriminer ce qui est une psychothérapie et ce qui ne l’est pas) serait représentatif de quoi que ce soit. Pour relire ensuite le cas qu’elle offre, celui de la religieuse violée, il est lui-même obscur (le « développement personnel » est-il une psychothérapie ? En quoi s’agissait-il d’ailleurs de « développement personnel » plutôt que de n’importe quel happening ? Est-ce donc la psychothérapie supposée elle-même qui est en cause, et non la fraude, ou l’usurpation de titre ? En quoi enfin ce viol n’est-il pas un viol par séduction ordinaire, qui aurait pu se passer avec ce thérapeute comme avec un prêtre ?). J’insiste sur le caractère naïf de ces questions. Le point frappant, c’est que Sironi en tient les réponses pour si évidentes, qu’elle ne songe pas un instant qu’un contre-exemple à l’irénisme de Jacques-Alain Miller, son adversaire, ne prouve pas qu’il se trompe. Mais on a deviné ce qui se passe : c’est que le lieu d’où elle parle, d’où elle vise la psychanalyse comme un obstacle à la salutaire régulation des psychothérapies, est un lieu d’élaboration théorique antagoniste, qui veut faire reconnaître sa supériorité : on y promeut une technique psychodynamique anti-freudienne, imprégnée d’ethnopsychiatrie, et qui prend au sérieux la problématique de la Trauma Theory. Je vais y revenir, mais on peut déjà la réduire en gros à cette idée qu’il y a des traumatismes réels (et non fantasmés, comme le soutenait Freud). La cure par la parole est alors incriminée comme une pratique de quasi « tortionnaire », dans la mesure où elle donne au traumatisme un doublon psychique, à verbaliser impérativement. Le tour particulier que lui donne Sironi, c’est qu’en enracinant ces traumatismes réels dans un contexte politique, elle entend créditer par ricochet les usagers qui se plaignent (ou se plaindraient) d’une vertu civique. Ce ne sont pas des « naïfs », encore moins des névrosés qui fantasment, mais l’extension contemporaine de cette vaste masse de femmes effectivement martyrisées qui ont renversé politiquement les diagnostics d’hystérie et d’autosuggestion où la psychanalyse les enfermait.
Laissons de côté le débat doctrinal. Car, paradoxalement, de telles conjectures révèlent surtout l’extraordinaire mépris qu’on voue au dit sujet « politique », comme au sujet du droit. Déjà, l’exposé sommaire qui précède l’amendement Accoyer contenait les propos suivants : « [les psychothérapies prétendues] peuvent faire courir de graves dangers à des patients qui, par définition, sont vulnérables et risquent de voir leur détresse ou leur pathologie aggravée. Elles connaissent parfois des dérives graves. Depuis février 2000, la mission interministérielle de lutte contre les sectes signale que certaines techniques psychothérapiques sont un outil au service de l’infiltration sectaire et elle recommande régulièrement aux autorités sanitaires de cadrer ces pratiques. » Or, comment ne pas voir que si on ne commence pas par supposer assez de bon sens à une personne qui souffre psychiquement pour distinguer le violeur du thérapeute, il n’y aura pas de limites au réseau de protections dont il faudra l’entourer ? Non seulement il n’existe pas de loi contre ceux qui enfreignent la loi, uniquement des peines, mais les lois ne peuvent pas être rédigées pour ceux qui ne sont pas raisonnables. Et on peut souffrir psychiquement et être raisonnable. Ou alors, disons les patients mineurs jusqu’au bout, et prenons sur nous de porter plainte contre leurs thérapeutes, même s’ils s’en estimaient contents — pauvres victimes inconscientes à protéger de leur inconscience ! Du cas particulier (tel abus), on ne peut justement pas aller au cas général sans détruire ici ce qui fait du cadre un cadre légal. Mais l’arsenal juridique pour punir existe : il suffit de juger pour escroquerie, viol, etc. Dans ce système ambigu, où l’on mobilise de la main droite l’usager-citoyen en lui imputant de la main gauche une faiblesse psychique disqualifiante, nul doute que les experts vont proliférer, capable de discriminer les seuils inscrutables, voire, comme Sironi, d’écarter à coup sûr les effets (si évidents) d’un « transfert négatif »[17] . Or c’est en toute franchise que Sironi se place sous le patronage du Centre Georges Devereux, et qu’elle tient pour naturel de glisser des sectes aux psychothérapies. Il n’en est pas moins entièrement conjectural qu’on puisse empiriquement lier psychothérapies et sectes, ou parler d’abus majeurs liés aux psychothérapies en tant que telles. Il n’est pas exclu qu’un tel lien soit établi un jour ; mais pour le moment, qui s’en est donné les moyens ?[18] . Ce qui donc émerge du débat, c’est plutôt la mise en forme militante de ce que je ne crains pas, jusqu’à preuve du contraire, d’appeler des « fantasmes d’usagers » : où se dessine en creux une figure normative nouvelle de ce que les gens devraient attendre de leurs psychothérapies (pour ne pas être dupés), où s’esquisse aussi la mise sous tutelle soft d’aspirations intimes. Bien sûr, tout cela ne fait pas partie du programme politique de Sironi ; elle l’a prouvé par d’autres travaux[19] . Mais c’est en quoi son article est exemplaire : il fraye la voie au strict contraire de ce à quoi elle aspire. Malheureusement, le contexte sécuritaire du débat sur la santé mentale laisse présager le pire, tant l’image des abus dans les médias tend à recouvrir leur proportion dans des ensembles sociaux déjà lourdement régulés.
Les réticences de l’establishment médico-psychologique à un traitement radical de la question des psychothérapies sont, je suppose, encore un autre obstacle méconnu à la simple formulation des bonnes questions. Une mauvaise conscience certaine envahit depuis peu les hôpitaux universitaires. Sans doute, l’idéologie majoritaire soutient encore que le psychiatre est ès-qualité psychothérapeute (puisque la psychothérapie qualifie un acte médical, et qu’un interne est censé l’avoir appris durant les stages pratiques). Mais on voit s’ouvrir depuis 2000, à gauche et à droite, dans les facultés de médecine, sur le modèle du Diplôme Universitaire de Lyon, des DU de psychothérapie, pour lesquels se trouvent assez miraculeusement des fonds et des enseignants. On est loin encore de se demander si le modèle suisse ne serait pas le bon, où le psychiatre doit par principe se former dans un organisme extérieur, conventionné par les cantons, à une technique qui implique un « travail personnel » (la psychanalyse, mais pas seulement). Toutefois, en France, coexiste avec la confiance dans le titre de psychiatre les restes de la période ancienne, où il était clair, précisément parce qu’on était psychiatre, qu’il fallait faire en plus une démarche personnelle (idéalement une analyse). Dans des hôpitaux du cadre, à la différence des hôpitaux universitaires, une petite pression continue, semble-t-il, à s’exercer dans ce sens. Or un mouvement de ce type serait peut-être en train de renaître, à la faveur d’une modification insensible des attentes de jeunes internes davantage demandeurs de recherches psychologiques[20] .
Or, là encore, les enjeux sont complexes. Le rapport Pichot-Allilaire de 2003, de façon transparente, conçoit la psychothérapie comme un acte complémentaire de la prescription de psychotropes. Il en ressort que la psychothérapie en elle-même, si elle est pratiquée à part par un psychologue, ne saurait en son fond valoir que sous la tutelle du médecin prescripteur, qui devrait rester aussi l’évaluateur. Ce rapport reflète des soucis venus des Etats-Unis : les enquêtes attribuent toujours la palme de l’efficacité aux thérapies combinées (psychotropes et TCC), mais les assurances remboursent les médicaments, pas le suivi psychologique, alors qu’il est raisonnable de penser que le jeu en vaudrait la chandelle. D’où le souci des autorités médicales de protéger le label « psychothérapie » de l’invasion par des pratiques informelles, non seulement parce que le statut du psychiatre en tant que vrai thérapeute de l’esprit serait dégradé, ou du moins banalisé, mais aussi parce que les maladies psychiques ne peuvent pas devenir aussi informes que ces malaises diffus à quoi s’adressent les thérapies informelles : la dépression dite « résistante », les troubles obsessionnels-compulsifs, les phobies, voilà du dur. Le mou, ce sont les deuils transitoires, les dépressions qui cèdent sous placebo, etc. La pente sociale à instrumentaliser les psychiatres comme des religieuses laïques au secours de troubles fluctuants hérisse notoirement la profession, qui ne s’intéresse au tabagisme que si c’est une addiction, ou aux malheurs de la vie que dans le cadre du stress post-traumatique constitué. Ces inquiétudes motivent la pression médicale pour réglementer les psychothérapies. C’est un renforcement indirect du périmètre de l’exercice légitime de la médecine mentale, qui soigne des maladies qui sont de vraies maladies. Entre les compétences neurobiologiques qui font le prestige des hiérarques, et le tout-venant de la misère hospitalière et extra-hospitalière, la zone intermédiaire indécise exige des défenses solides. D’un autre côté, on aurait tort de croire les professeurs acquis unilatéralement aux neurosciences ; la nostalgie de la vieille clinique les hante encore. Pourvu qu’elles offrent des garanties de sélection, les écoles de psychanalyse huppées et orthodoxes n’ont pas perdu la bataille. Mais ce tropisme compréhensible des mandarins risque de se heurter à une autre contrainte, qu’on a perdue de vue dans les débats d’après l’amendement Accoyer alors qu’elle était au cœur des soucis dans la discussion qui l’a précédé. Car si l’on déshospitalise en masse (fermeture de lits, substitution de nouveaux neuroleptiques moins sédatifs aux anciens, gros efforts de réinsertion sociale, collaboration avec les familles, les associations, etc.), il n’en reste pas moins que les files actives des CMP (Centres Médico-Psychologiques), qui sont comme les bassins de refoulement des pavillons fermés des asiles, tendent désormais vers l’infini. Il faut donc assurer des soins hors-hôpital à une cadence infernale. Des psychothérapeutes accrédités désengorgeraient le système. Il est clair toutefois, qu’il en faudra plus que l’élite choisie des grandes sociétés de psychanalyse. Il faudra faire des compromis.
Mais il n’est pas sûr que les TCC puissent entièrement prendre en charge ce champ, dans la mesure où, dans la nature, et non plus en laboratoire, les supériorités vantées de ce modèle sur les psychothérapies dynamiques (psychanalytiques, surtout), fondent comme neige au soleil, sous la pression de la demande des patients, toujours plus complexe que prévue, et de l’ethos particulier qu’exige le suivi au long cours de malades chroniques[21] .
Du côté des professeurs de psychologie, la même supposition prévaut que le diplôme de psychologue-clinicien devrait suffire (tellement les stages mettent les étudiants au contact de patients et de superviseurs expérimentés). De même, survit la pratique de la démarche personnelle hors du cadre universitaire, du fait même qu’on est psychologue, et sans qu’elle soit imposée par autre chose que l’idéalisation du rôle à jouer. Or le fait est qu’il n’y a pas de formation à la psychothérapie à l’université.
Avouant à demi-mot la difficulté à laquelle l’acculent certains psychothérapeutes militants (qui invoquent des « formations » aux délais ahurissants : des années pour apprendre la bio-énergie !), Roland Gori a fait circuler un projet de refonte des cursus parant la critique[22] . Il veut prendre à contre-pied ce que Françoise Champion appelle les « psychothérapeutes non-académiques » (car ils peuvent être diplômés, ce qu’ils font n’est pas légitimé par l’université). Bien documenté, ce rapport compare les programmes universitaires européens, afin de ne pas compromettre le pilier de l’institution psychologique en France, la loi de 1985, qui protège le titre de ses diplômés[23] . Il suggère de spécialiser certains psychologues par un renforcement de leur expérience clinique, avec deux idées en tête : pallier « la pénurie de psychiatre » (alors que la France a un taux de psychiatres par habitants des plus hauts du monde), et répondre aux demandes de soins plus informelles, en protégeant le public des charlatans. Puis Gori réclame, en échange des efforts, des postes pour les psychologues ainsi formés. Qui peut croire que de tels postes ne conduiraient pas à des statuts les protégeant ?
La critique du modèle subordonné de psychothérapie (un supplément aux psychotropes) est également très nette. Il est hors de question de céder sur le privilège des psychologues, garanti en 1985, de faire des diagnostics et de participer aux soins de façon autonome — ce qui est, notez bien, en contradiction avec l’article L372 du Code de la santé publique, qui fait de tels actes un exercice illégal de la médecine.
Or, tout cela rend pressant « le » problème : comment ne pas diluer la psychologie comme science ? Comment éviter l’inscription fatale des psychologues dans le Code de la santé publique au titre IV des « professions de santé », en compagnie des sages-femmes et des dentistes, avec sa réduction à une simple technique et la subordination aux médecins qui en découle aussitôt ? En la divisant en spécialités, comme la médecine — et implicitement, à parité, propose Gori. Sans que les choses soient si claires, son propos suggère néanmoins que les psychothérapeutes dûment formés seraient comme des psychiatres-sans-médicaments, sans que ce soit une déficience plus grave que d’être cardiologue sans rien savoir du cancer du foie. La querelle des psychothérapeutes, on le voit, est ici l’occasion « d’aller plus loin », dit Gori : en fait de relancer la guerre avec les psychiatres (encore que les deux clans s’entendent pour dénier aux généralistes la moindre compétence psychothérapeutique !). Mais une part de son argument consiste alors à retourner contre la psychiatrie sa crainte d’être débordée par des demandes impossibles à satisfaire, d’origine sociale, ou pire, politique, qui prendrait la forme gênante de symptômes mentaux sous-déterminés : aux psychothérapeutes de prendre ces mal-être en charge, pour prévenir, contre les effets pervers du paradigme objectiviste et donc impersonnel de la médecine scientifique, toutes les frustrations dont font état les malades, au point de porter leurs griefs en justice. On ne saurait mieux offrir une solution clé en main au malaise social, au moyen de ce qui est, quoi qu’on dise, une offre « technoscientifique » des psychologues. La prédiction de Robert Castel touchant les psychologues des années 80 se réalise : « la présence de cette masse de qualification sans emplois pousse à la création d’emplois correspondant aux qualifications, et contribue ainsi au développement du champ médico-psychologique et médico-social »[24] . Or les psychologues ont-ils les moyens de jouer ce rôle de charnière ?
J’aimerais savoir, pour mentionner le rôle envisagé de tampon entre les sujets et la technostructure médicale, ce qui protégerait les protecteurs, et qui bloquerait la judiciarisation des actes psychothérapeutiques censés anticiper la judiciarisation des actes médicaux... Sans compter le décalage suspect entre le discours humaniste, anti-scientiste, et l’offre plus tactique d’un pansement psychosocial là où ça fait mal. En somme, psychiatres et psychologues sont profondément atteints par l’affaire du statut des psychothérapeutes : c’est le périmètre de leur pratiques légitimes qui tremble sous le coup de la demande sociale. Et si les psychologues en profitent pour s’aventurer, au moyen même de cette pression sociale, sur la chasse gardée des psychiatres, ces derniers se barricadent derrière un positivisme de bon aloi — ce qui pourrait, si l’on n’y prend garde, rallumer les feux de l’anti-psychiatrie la plus bête. Or, le commun dénominateur de ces deux mouvements est simple : c’est l’incapacité à mettre en perspective critique le mythe de la « demande des usagers », tenue pour un fait brut.
Ces trois obstacles à l’élaboration des bonnes questions semblent donc déboucher sur des questions de sociologie : que sait-on, au juste, du public qu’on s’empresse de protéger, qu’on aplatit sur le seul rôle des « usagers », et plus généralement, de la fonction sociale des soins psychiques (informels ou véritablement thérapeutiques) dans le champ actuel de la santé mentale ? Que sait-on, ensuite, des « psys », tels qu’on les amalgame (universitaires et non-universitaires, employant des techniques reconnues ou pas, et sans que ces deux dimensions coïncident toujours) ? Va-t-on aujourd’hui remplacer l’enquête empirique sur qui, quoi et comment, par un « principe de précaution » appliqué lui-même sans précautions ?
Or que sait-on donc, sociologiquement, de ces problèmes ? La réponse est claire : rien.
Je n’ai aucune volonté provocatrice : que le lecteur essaie d’évoquer une référence docsgraphique majeure sur l’évolution des traitements psychothérapiques considérée comme problème social et politique, depuis les années 80, une étude épidémiologique de l’INSERM, le moindre rapport du Ministère de la santé ; en sociologie, quelques chapitres dispersés[25] ; en économie de la santé, le néant. Le sondage BVA dont j’ai parlé plus haut n’est significatif de rien, ai-je dit : je me reprends, il est significatif, accompagné de ses commentaires biaisés, du vide qu’il sert à couvrir. Il semble qu’après la magistrale Gestion des risques de Robert Castel, en 1981, il y a 25 ans, la recherche sur le domaine se soit entièrement tarie[26] .
Voilà pourquoi ce livre offre une base commode : en mesurant les décalages entre ce qu’il prédisait et ce qu’on peut observer aujourd’hui, le phénomène actuel pourra peut-être donner lieu à des hypothèses moins soumises aux passions que celles qu’on nous assène en ce moment comme des évidences — qui imposeraient, en plus, des plans d’urgence.
Robert Castel énumérait trois axes qui paraissaient, en 1981, commander l’évolution à venir de la santé mentale, autour des psychothérapies envisagées comme des faits sociaux, scientifiques et politiques :
« [1.] un retour en force de l’objectivisme médical qui replace la psychiatrie dans le sein de la médecine générale ;
[2.] une mutation des technologies préventives qui subordonne l’activité soignante à une gestion administrative des populations à risques ;
[3.] la promotion d’un travail psychologique sur soi-même qui fait de la mobilisation du sujet la nouvelle panacée pour affronter les problèmes de la vie en société »[27] .
Je propose de reprendre ces entêtes avec l’hypothèse que l’amendement Accoyer, dont il est vain de croire qu’il tombe du ciel, marque dans un processus ancien une césure définitive.
1. Le retour dans le giron de la médecine générale est aujourd’hui devenu un mot d’ordre de la psychiatrie universitaire dont l’intelligence exacte est cruciale. Il a de multiples significations, mais on peut exploiter ses incidences sur les psychothérapies pour apprécier la force des courants qui portent l’appel à la réguler. Car ce mot d’ordre consomme la captation du discours légitime en psychiatrie par les enseignants des facultés, au détriment des psychiatres du cadre, ce que parachève depuis peu la confiscation totale des internes par les hôpitaux universitaires. Or, l’élite académique étant sélectionnée par le biais tyrannique de la publication dans des revues à impact-factor élevé, leur excellence se mesure à la virtuosité dans le maniement de la psychométrie, et moins au talent clinique qu’aux compétences neurobiologiques[28] . Ce qui a changé, toutefois, c’est l’émergence de neurosciences psychiatriques enfin intéressantes ; elle a dédouané la psychiatrie universitaire de la tare de conservatisme réactionnaire dont parlait encore Robert Castel, et qui, dans les années 70, avait déclenché l’insurrection des hospitaliers du cadre, plus engagés socialement. Il y a de meilleures raisons, en 2003, de faire confiance au progrès scientifique en psychiatrie. Or la TCC, type de la thérapie objective, quantifiable (donc publiable par les journaux médicaux indexés), viendrait aussi, croit-on, à la rencontre des besoins des hôpitaux qui gèrent le gros des malades. Car si ces derniers déshospitalisent sous la contrainte budgétaire, l’externalisation des patients crée des besoins de suivi considérables, et implique de faire d’emblée barrage à l’occupation des lits qui subsistent par de petits névrosés de ville. Entièrement conjugable avec les psychotropes, la TCC apparaît dès lors comme la panacée[29] . Le principe d’évaluation permanente qui la régit comble les technocrates, d’autant que sous sa forme standardisée, la TCC accepte de réadapter un patient en fonction de son idée de la normalité (on y liquide un symptôme « local ») sans interroger la demande de soin elle-même, ni la personnalité. Du coût, le ratio coût/bénéfice se chiffre. Quant aux soupçons éthiques qui grevaient les thérapies comportementales des années 70, ils sont balayés : l’éthique est devenue un paramètre, mis en balance avec l’utilité sociale ou privée — voire quelque chose dont on pourra poser la question, mais une fois le symptôme traité… C’est l’abstention médicale traditionnelle à l’égard des usages de la santé recouvrée. Mieux, comme ces thérapies sont aussi cognitives, elles échappent au reproche de n’impliquer aucun « travail sur soi » : le soi existe, dans la TCC — avec ce paradoxe, dont la réalité est désormais statistique, de passerelles multiples entre TCC et psychothérapies dynamiques, des patients décidant de poursuivre en psychanalyse l’exploration de ce soi, ou à l’inverse, contents de leur psychanalyse, venant en TCC pour liquider un résidu de symptômes[30] . Enfin les TCC ne sont pas uniquement réductibles à des stratégies d'adaptation aveugles aux demandes de l'entourage (et par extension à des représentations idéologiques de la normalité sociale); un de leurs intérêts largement méconnus par leurs critiques sociologues ou psychanalystes, mais pas du corps médical, est leur usage dans l'adaptation mentale de certains patients à la maladie somatique grave: affection cardio-vasculaire (l'angine de poitrine avec son cortège anxieux), ou certains handicaps (après des opérations mutilantes), etc. Cependant, l’appropriation par les universitaires du discours scientifique légitime coïncide, en face, chez les psychiatres du cadre, avec une crise intellectuelle intense. Littéralement esclaves de dispositifs sociaux qui faisait la raison d’être du secteur à la française, mais qui, avec la pénurie, dévorent désormais leurs forces vives, les services ne transmettent plus de savoir clinique autonome. Quant à la psychothérapie « institutionnelle », ce pilier de l’ethos psychiatrique depuis Esquirol, le désert croît. Car qu’est-ce qu’une institution peu à peu dépouillée de son personnel ? On assiste alors, par un renversement inouï, au retour de certains psychanalystes à l’hôpital, mais non plus, comme dans les années 70, pour contester le modèle asilaire de la maladie mentale : pour y refaire des présentations de malades (!) et maintenir la mémoire de la clinique des « classiques » (c’est frappant chez les lacaniens, qui ont republié quantité de travaux historiques).
Ailleurs, les thérapies familiales font l’objet d’investissements passionnés. Mais partout, sans doute pour préserver a minima la dignité intellectuelle de l’activité soignante, les psychiatres s’agitent. On peut alors redouter deux choses. La première, ce sont les effets ponctuels de la disparition de la prise en charge totale, sinon totalitaire, qui était autrefois la norme pour les malades mentaux. Au mieux « vus », mais sûrement plus « suivis », ces derniers recherchent hors-hôpital qui les accompagnera. Il faudrait d’ailleurs vérifier avec soin l’impression banale des psychanalystes non-médecins qui voient sonner à leur porte des psychotiques las des files d’attente du service public et de la superficialité des entretiens qu’on est malheureusement réduit à leur accorder [31] . La seconde, plus générale, est que la dialectique de l’individu moderne ne se réduit pas au mythe des « usagers de la santé mentale ». Rien ne prouve que l’intention louable de satisfaire le client dans des structures contrôlées n’engendre pas mécaniquement, à la marge, un refus armé de laisser médicaliser tous les troubles. Les passerelles entre TCC et autres thérapies, l’éclectisme, en somme, des démarches, sont à ces égards significatifs. L’usager-citoyen pourrait aussi préférer la non-intervention de l’Etat pour des raisons de fond[32] .
De toutes façons, les droits concédés à l’usager-citoyen de la santé mentale ne le sont que dans un cadre médico-administratif qui vise surtout à se protéger de lui et de ses plaintes. Les thérapies alternatives non-conventionnelles ont alors de beaux jours devant elles, surtout si la prescription de psychotropes par les généralistes continue à servir de base indiscutée du traitment et l’indication de psychothérapie de supplément luxueux. On pourrait même voir, je le redis, se rallumer devant ce déni institutionnel d'attention à la « personne globale », l’incendie de l’anti-rationalisme anti-psychiatrique le plus néfaste.
2. Touchant la seconde thèse de Robert Castel, il est clair en ce moment que tout le projet « disciplinaire » de la santé mentale, si redouté des intellectuels de gauche des années 80, s’est entièrement effondré[33] . La gestion des populations à risques n’a plus besoin de caution psychiatrique forte. Le traitement social de la misère suffit. Franchement, pour le fonctionnaire de mairie distribuant de maigres secours, quelle différence pratique entre un psychotique, un peu délirant et agressif, et un chômeur en colère, analphabète et alcoolisé ?
L’aiguillage diagnostic et l’expertise psychotechnique, s’ils n’ont pas disparu, semblent aujourd’hui les dernières pudeurs d’un âge d’abondance médico-sociale révolu. Robert Castel identifiait à l’époque une double tendance : d’une part, une volonté de psychiatriser-psychologiser la condition de populations à risques, et d’autre part, la promotion individuelle d’un « potentiel psychologique » à intensifier. Mais un second double mouvement, superposé à et non complémentaire au premier, naît sous nos yeux, qui importe suprêmement aux psychothérapies. C’est ce second mouvement dont je me demande s’il n’est pas la grande leçon à tirer des événements actuels : en somme, l’amendement Accoyer formalise l’émergence d’une notion élargie de santé mentale (plus seulement psychiatrique ni psychologique, mais tendant à légiférer sur le « bien-être » en général) entendue comme un enjeu collectif, voire un projet de société, et il inscrit dans ce cadre nouveau le projet d’une prise en charge ciblée d’individus à risques, que la loi doit protéger en tant qu’individus (autrement dit, non plus, ou plus seulement parce qu’ils appartiennent individuellement à une population à risques, mais parce qu’en tant qu’individus ils ont des droits sociaux à la santé mentale). Ce sont là des processus de fond, et on voit pourquoi l’amendement Accoyer traduit une anxiété compréhensible devant la zone floue qui voit les mêmes anciens agents informels du « potentiel psychologique » à intensifier, lesquels ne dérangeaient pas grand-monde et faisaient plutôt sourire, lentement s’approprier des plaintes plus graves, plus médicalisables, sans qu’on ait vu où la ligne jaune était franchie. Certes, cet amendement pourrait évoluer dans sa forme ; mais les problèmes auxquels il tentait de faire face, même sans le savoir, restent. Qu’on médite ainsi sur l’explosion de la victimologie, sur le recours confusionnel à l’idée de traumatisme, sur l’exigence de « cellules psychologiques d’urgence », non seulement suite aux catastrophes, mais, on l’a vu, à l’annonce d’un licenciement collectif[34] . Car, pour aller vite, dès le moment où le fait que la plainte du traumatisé ne soit pas « entendue » (i.e. entendue comme il faut qu’elle le soit de son point de vue à lui) est considéré comme un redoublement de son traumatisme, tout le surplomb objectivant du praticien traditionnel de la santé mentale sur son « cas » paraît barbare. Or la prolifération des traumatisés est un fait social (que de nouveaux harcèlements, sexuel, moral, etc., construits comme des pathologies mentales !). A cet appel à être entendu, fait pendant une offre « d’écoute » tous azimuts. Or, loin de préserver, comme le suppose Jacques-Alain Miller[35] , un îlot de subjectivité dans le monde cruel de la technomédecine, elle risque de prendre à revers tous ceux qui n’ont que leurs titres de science à opposer à l’empathie un peu poisseuse des écoutants humanistes ; voire de servir à désigner les esprits critiques, et je pèse mes mots, à la vindicte populaire. Il y a là, en tout cas, une inépuisable ressource pour des psychothérapies alternatives qui se serviront, à n’en pas douter, de l’anti-scientisme comme d’un étendard. Nulle loi, sauf à être longuement pesée, ne fera obstacle à cette radicalisation, si elle ne l’accélère pas.
Or c’est là, je crois, un réseau de faits sociaux infiniment plus prégnants que le mythe bureaucratique de l’usager de la santé mentale. Il devrait susciter des pouvoirs publics plus d’attention qu’aux rumeurs et aux scandales ad hoc. Car « l’individu à risques » (la victimologie en offre un exemple parmi d’autres) mérite un examen dont les modalités sont presque toutes à inventer. Toute loi sur les psychothérapies aurait besoin de s’en informer, plutôt de ne voir que ce que la bureaucratie sait gérer par ailleurs : des « usagers » gentiment organisés en associations-partenaires, occasion, enfin, de se défausser de responsabilités publiques en les privatisant par consensus[36] .
3. C’est alors l’évolution de la culture psychologique de masse qui doit nous intéresser[37]. Comment, tout d’abord, est-on passé de pratiques plutôt libertaires, voire opposées à la société de consommation, qui visait l’épanouissement du soi (la « self-activation » d’Abraham Maslow) et la réconciliation avec le corps, à ce colossal marché de la performance individuelle qui s’est approprié, à l’inverse, l’idéal d’une surnormalité heureuse, et a ainsi psychologisé « l’idéologie de la réussite » ? (Claude Boiocchi)[38] Comment, ensuite, le « développement personnel » (DP), qui se transforme depuis les années 80 sur cet axe, a-t-il pu se présenter comme base pour des thérapies, au point d’inquiéter les pouvoirs publics ? Voilà qui force des aveux gênants.
Car il faut savoir que 10% des livres vendus dans le monde sont du DP. Un monument de la littérature New Age comme La prophétie des Andes, de James Redfield, a atteint 100 millions d’exemplaires. La cassette-vidéo d’Anthony Robbins, Personal Power, a trouvé 25 millions d’acheteurs à 69,95$ pièce. La puissance de la pensée positive de Norman Peale, traduit en des dizaines de langues, s’est vendu à 15 millions d’exemplaires. Et ce n’est nullement un phénomène occidental : avec l’ouverture de la Chine sur le monde, le DP a pénétré une culture qu’on n’aurait pas imaginé si réceptive (de 1986 à 1989, pendant ce qu’on a appelé la « Maslow craze », il s’est écoulé presque 600000 exemplaires de ses ouvrages de psychologie humaniste). Des groupes de presse internationaux, comme l’ancien Vivendi Universal Publishing, ont manœuvré pour s’assurer le contrôle de collections si rentables (comme les Presses de la Renaissance). A la différence de ce qu’observait Robert Castel, le phénomène n’est plus marginal. Les classes moyennes et supérieures dévorent du DP ; ses stratégies ont été intégrées par de grandes entreprises, pour sélectionner à l’entrée puis pour ventiler leurs cadres et entretenir la « capacité au changement ». Pour marquer fortement les choses, l’irrationalisme dans la « direction des ressources humaines » présente peut-être un danger beaucoup plus grand pour la santé publique que les manipulations imputées aux sectes ou aux psychothérapeutes informels ; le mettre en évidence serait toutefois moins consensuel. Or cela, tout le monde en parle dans les milieux médico-psychologiques, mais personne ne sait l’analyser. Il faudrait donc s’immerger dans cette littérature, et chercher comment s’est opérée la dérive qui, de l’apologie d’une surnormalité épanouie, a conduit à remédier aux déficits ponctuels de tel ou tel dans sa vie professionnelle ou sentimentale, pour évoluer peut-être vers des pratiques prenant l’ensemble de la vie en charge, troubles psychiques compris, et qui concurrenceraient peut-être les psychothérapies sérieuses sans avoir jamais l’air d’être autre chose que des « thérapies pour normaux ». Les modalités de cette évolution, et surtout, si elle est si claire et si dangereuse que cela, sont aujourd’hui inconnues. Et il est quand même curieux de légiférer sur des techniques dont on ignore tant : nombre de clients, distribution par catégories socio-professionnelles, répartition géographique, sommes en cause, cadres juridiques, nature des pratiques suspectes, effets thérapeutiques, idées qu’elles se font de leur identité et de leur légitimité, origine historique, parcours-types, etc[39] . Il a suffi qu’on découvre que n’importe qui pouvait se dire « psychothérapeute » pour qu’un fait de société aussi dense devienne la cible de velléités d’encadrement légal, justifiées a posteriori par des scandales dont nul ne sait s’ils sont exemplaires ! On se gardera donc d’accroître la confusion, en pointant cependant plusieurs éléments aisés à vérifier. Le premier, crucial pour comprendre le jeu des « psychothérapeutes non-académiques », c’est que ce jeu est un double jeu. Carl Rogers, mort en 1987, inventeur de la client-centered psychotherapy, l’a bien formulé[40] . Le patient, dit-il, ne doit pas être un patient, mais un client. Double jeu, double gain : cela fait du bien aux gens de se voir autrement que comme des malades, même s’ils sont venus exposer de graves difficultés mentales, et protège aussi le thérapeute, qui engrange le bénéfice d’une demande de soins implicite et déculpabilisée, mais sans pratiquer illégalement la médecine. Ainsi, il n’y a plus que deux personnes face-à-face dont, à la limite, il est presque « indifférent de dire que l’un est le thérapeute et l’autre le patient » (Claude Boiocchi). Une autre astuce est la promesse implicite de guérison dans l’adoption d’un style de vie psychologiquement régulé, en groupe, ou seul. Son moyen typique est le commentaire extatique du client dans les préfaces ou sur les quatrièmes de couverture des livres de DP : là, le client assume seul la réalité vécue de son mieux-être, sans que son maître à penser ait fait autre chose que donner l’exemple. Or il s’agit souvent de dépressions, de phobies, d’épisodes névrotiques sévères — au point qu’on enrage qu’il n’existe aucun délit de guérison illégale… Ce dispositif, il faut enfin l’avouer, restera insaisissable. Social (sinon enraciné dans des structures psychiques profondes), il fuira par les mailles du filet, si serrées soient-elles. Exquise impudence, un site en ligne de psychothérapeutes informels proposait d’ailleurs l’ultime parade à l’amendement Accoyer : se dire non plus bio-énergéticien, sophia-analyste, mais « psychothérapeute européen » — ou bien psychanalyste, puisque leur statut serait mis à part…[41]
C’est donc sur la psychanalyse que j’entends conclure.
Il est vraisemblable que l’amendement Accoyer frappait paradoxalement à peu près la seule psychothérapie pratiquée par des non-médecins et des non-psychologues sur laquelle on puisse avoir des garanties, tout en n’empêchant pas que les pratiques douteuses se perpétuent. (Mutatis mutandis, on risque une législation aussi fragile que les lois anti-sectes, qui mordent sur les libertés publiques et s’exposent à l’arbitraire des tribunaux.) La première menace sur la psychanalyse est le tarissement de son recrutement hors du milieu médico-psychologique. Mais c’est une forte caution, je pense, que des linguistes, des juristes, des sociologues, des philosophes, des biologistes ou des mathématiciens, se destinent à cette discipline, et se plient aux formations dispensées dans des institutions qui existent depuis des dizaines d’années, et dont les travaux sont célèbres. C’est même le champ entier de la santé mentale qui s’est ouvert en grand aux sciences sociales ces dernières années, précisément pour se mettre au diapason de son objet. Il faudrait alors estimer combien, ni psychiatres ni psyc